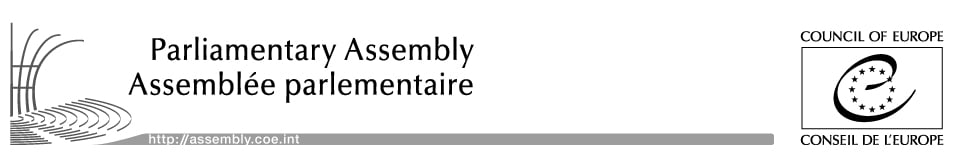Harold
Wilson
Premier ministre du Royaume-Uni
Discours prononcé devant l'Assemblée
lundi, 23 janvier 1967

Monsieur le Président, c’est pour moi un honneur que d’avoir été invité par vous à prendre la parole devant cette Assemblée, cet après-midi. Je suis particulièrement heureux de le faire sous votre présidence. En effet, votre élection n’a pas seulement réjoui tous les amis que vous comptez à la Chambre des Communes de Grande-Bretagne, mais elle a fait naître des espoirs qui se sont abondamment réalisés. Nous savions qu’en votre personne la Grande-Bretagne mettait un grand Européen au service de l’Europe pour cette période et nous étions non moins conscients du fait que la voix de l’Europe ne cesserait jamais de se faire entendre à la Chambre des Communes de Grande-Bretagne.
Je me reporte par la pensée sept ans en arrière à la dernière fois qu’un de nos collègues a présidé, avec tant de distinction, cette Assemblée. Je veux parler d’un très bon ami à moi – qui était aussi l’ami de beaucoup d’entre vous: le regretté John Edwards, disparu tragiquement avant l’âge ici même, à Strasbourg. Pendant toutes ces années, John habitait près de chez moi, comme il était près de moi par l’esprit. Nous nous rendions chaque matin à la Chambre dans ma voiture et nous rentrions ensemble, en général tard dans la soirée. Combien de fois – je m’en souviens parfaitement – m’a-t-il parlé des grands remous qui agitaient cette Assemblée et de la grande vision qu’il avait de l’Europe à venir, cette Europe dans laquelle il aurait – nous le savons tous – joué un rôle éminent, un rôle historique!
Cette Assemblée et toutes les autres activités multiformes qui se sont concrétisées sous l’égide du Conseil de l’Europe représentent l’unité dans la diversité: une unité de dessein et de vision rendue d’autant plus réelle par la diversité à partir de laquelle elle se crée. Car l’unité de l’Europe, loin d’être en contradiction avec son évidente diversité, se trouve, en fait, enrichie par les apports divers que peuvent fournir tant de nations si différemment douées par la géographie, l’histoire et la culture.
«Qui refuse le changement est l’architecte de la décrépitude. La seule institution humaine qui refuse le progrès est le cimetière.»
Nous qui sommes citoyens de ce grand continent avons le droit d’être fiers du rôle que nous avons joué dans l’histoire, et avant tout dans la création de grandes nations – elles-mêmes diverses – au-delà des mers. Et si, dans un monde qui se rétrécit rapidement, nous avons à présent un grand défi à lever, face à d’irrésistible poussée de nouvelles nations populeuses et affamées, un accommodement fondé non plus sur ce que nous pouvons leur prendre mais bien sur ce que nous pouvons leur donner, ce n’est nullement tomber dans l’introversion ou l’autosatisfaction que de puiser dans la richesse de notre propre passé européen. Nous serons capables, avec toute la force massive dont nous disposons collectivement, de fournir l’effort que nous avons à faire, et qu’il nous faut faire, en faveur des nouvelles nations d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine – un effort qui exigera une force réellement massive – si notre Europe elle-même est unie et forte.
De même, les nations ici représentées ne sauraient rendre effective la contribution exceptionnelle qu’il est en leur pouvoir d’apporter à la réalisation de la paix tant que nous ne serons pas parvenus à une plus grande unité de dessein. Une unité de dessein qui doit tendre non seulement à la résolution de nos propres problèmes en Europe – cette Europe plus vaste dont les frontières véritables transcendent les divisions artificielles approfondies par deux guerres mondiales – mais aussi au règlement des problèmes mondiaux plus vastes qui forment, d’année en année, la trame des discussions internationales aux Nations Unies.
On a dit à juste titre qu’aucun homme d’État ne peut espérer aborder les problèmes qui se posent dans son pays ou à l’échelle internationale sans être doué d’un sens très vif de l’histoire, et même d’imagination historique. Il est bien certain que nul ne saurait accepter le privilège qui m’a été conféré ici aujourd’hui sans être profondément conscient – et en même temps ému – de l’histoire des milliers de fils – d’or, de soie et de grosse laine – qui sont entrés dans le tissage de notre riche tapisserie européenne.
Nous en sommes encore à l’ère des États-nations. Vu dans une perspective historique, le concept d’une nation à laquelle chacun de nous doit appartenir est incroyablement récent: quant à la notion de race, elle est, pour n’importe lequel de nos peuples, soit inexistante, soit issue du cauchemar d’un psychopathe.
Il y a une semaine, un éminent anthropologiste annonçait des découvertes donnant à penser que l’homme – un homme peut-être légèrement différent de celui que nous connaissons – serait vieux de 20 millions d’années. Il y a deux mille ans – le dernier dix-millième de cette période, moins d’une demi-seconde de l’heure de l’histoire de l’humanité – le peuple britannique était déjà indistinctement créé par la colonisation d’une vingtaine de régions représentées ici aujourd’hui. Il y a mille ans, le nom même d’«Angleterre» reflétait les communautés des envahisseurs et des colons – les Angles et les Saxons se mêlant aux Danois et aux Celtes déjà établis de longue date avec leurs origines européennes diversifiées. Et si la démocratie, telle que nous la connaissons en Grande-Bretagne, a fait ses premiers pas dans ces communautés rurales en s’inspirant des modèles que nous avaient apportés les marins-paysans d’Europe, les institutions qui ont donné corps et substance à cette démocratie sont nées de la superposition des lois et des formes juridiques normandes, introduites en Angleterre il y a neuf cents ans par des hommes venus de France, eux-mêmes d’origine Scandinave.
De même, les grandes démocraties d’outre-Atlantique ont été créées par des colons européens, par l’émigration de ceux qui, dans les premiers temps, fuyaient l’Europe en quête d’une liberté de religion chère à leur cœur et, par la suite, tournaient le dos à la tyrannie ou à la famine. Les États-Unis eux-mêmes sont une création issue de la diversité européenne: leurs lois, leur culture, leur civilisation révèlent, de cent manières différentes, leur inspiration européenne. Aussi bien, lors d’une cérémonie anglo-américaine organisée récemment à la mémoire de Sir Winston Churchill, j’ai eu l’occasion de rappeler à nos amis américains non seulement que leur système de gouvernement repose sur des fondations britanniques, reprenant des idées originaires de France et d’autres parties de l’Europe (leur Constitution elle-même est fondée sur une division tripartite de l’autorité, dérivée de la «Séparation des pouvoirs» de Montesquieu, créant ainsi un système constitutionnel que l’on apprend à chaque écolier américain à respecter – et qu’il continuera à respecter, une fois adulte, avec plus ou moins d’enthousiasme), mais encore que, d’un point de vue historique, ce système doit être considéré comme reposant sur l’idée inexacte qu’un Français s’était faite de la pratique constitutionnelle britannique au dix-huitième siècle.
Je viens de faire allusion à Sir Winston Churchill, le plus grand patriote que l’Angleterre ait jamais connu. C’est lui pourtant qui, aux heures les plus sombres de 1940, vit assez loin pour proposer à une France investie un acte d’union indestructible entre nos deux pays. C’est la même vision qui l’incita, et qui incita un si grand nombre d’hommes politiques appartenant à tous les partis, en Grande Bretagne et dans chacun des autres pays ici représentés aujourd’hui, à proposer les initiatives qui devaient conduire au Conseil de l’Europe. À mes yeux, la portée historique du Conseil de l’Europe, et du mouvement européen de plus grande envergure dont il est une manifestation parmi d’autres, peut se définir ainsi. Solidement appuyés sur les réalités issues des cent cinquante dernières années d’histoire européenne, le cœur et l’esprit pénétrés des réalités et des besoins du siècle où nous vivons, le regard résolument tourné vers le siècle où vivront nos enfants et nos petits-enfants: telle est la position dans laquelle nous travaillons.
Car si le dix-neuvième siècle, ère du nationalisme, fut illuminé par l’héroïsme qui créa les grands États-nations, le vingtième siècle s’inscrira lui aussi dans l’histoire comme l’époque où des hommes eurent assez d’imagination pour créer, à partir de ces États-nations, sur les ruines de deux guerres mondiales engendrées par les conflits du nationalisme européen, une nouvelle unité fondée tout à la fois sur la raison et le sentiment. Une unité d’autant plus grande et d’autant plus réelle qu’elle s’appuie – en évitant de la rejeter – sur la diversité des États-nations, dont les traits et caractères particuliers se renforceront et gagneront en valeur à la faveur de leur fusion dans une unité plus large ouverte sur l’extérieur.
De même, dans un sens plus large, si les cent cinquante dernières années ont été l’ère de l’expansion coloniale – celle où Français et Hollandais, Portugais et Britanniques, et d’autres encore, partis de la longue côte dentelée de l’Europe maritime, furent suivis par les commerçants, les soldats, les administrateurs, les enseignants et les missionnaires – cette ère a maintenant cédé la place à une ère nouvelle, à un nouveau concept. Il ne s’agit pas d’un «repli de l’impérialisme» ni de «décolonisation», expressions qui ne font qu’accentuer le côté négatif de l’œuvre accomplie. Nous devons plutôt y voir une ère d’émancipation politique, de développement, de coopération, dans laquelle les puissances coloniales ont, l’une après l’autre, remis aux peuples qui leur étaient naguère assujettis la charge de se gouverner eux-mêmes et, tout en renonçant à exercer le pouvoir, ont forgé une nouvelle association qui, dans la majeure partie du monde nouvellement émancipé, a suscité une qualité d’amitié à laquelle la puissance colonisatrice n’aurait jamais pu prétendre.
Il en est ainsi dans le Commonwealth, un Commonwealth fondé sur l’égalité. Il en est ainsi dans l’association que la France et nos autres voisins ont maintenue avec ceux qu’ils dominaient jadis. Il en est ainsi dans l’activité du Conseil de l’Europe, de la Communauté Économique Européenne, de l’O.C.D.E.: par la coopération internationale, par des efforts et des sacrifices bilatéraux, nous avons, en Europe, tourné notre économie et notre industrie vers l’extérieur pour répondre aux besoins d’un monde en voie de développement.
Mais, comme je l’ai dit, cet effort ne pourra jamais atteindre pleinement son but, qu’il s’agisse du développement économique ou de la paix, tant que nous n’aurons pas appris à consolider, par une unité plus réelle, notre économie commune et notre force politique collective.
Car la puissance économique et l’unité politique doivent se développer de pair. Et, de même que nous souscrivons tous à ce principe que la puissance économique doit se développer dans le sens d’une ouverture sur l’extérieur, de même nous sommes tous résolus à nous assigner pour objectif politique non seulement de mettre un terme à la série de conflits qui ont déchiré l’Europe à deux reprises depuis le début du siècle, mais de chercher à établir d’abord un dialogue puis une paix réelle et active avec nos voisins de l’Est et, d’une manière plus générale encore, de renforcer la voix de chacun de nous dans les conseils mondiaux.
C’est dans cet esprit que la Communauté Économique Européenne a été créée. Dans une déclaration approuvée à une majorité écrasante à son congrès de 1962, mon propre parti s’exprimait en ces termes:
«Le parti travailliste considère la Communauté Européenne comme un grand dessein de conception hardie. Il estime que le rapprochement des six nations qui, par le passé, ont été si souvent déchirées par la guerre ou les rivalités économiques représente, dans le contexte de l’Europe occidentale, un pas d’une grande portée.»
Ce qui a donné lieu à controverse, en Grande-Bretagne, ce n’est pas, en effet, l’accomplissement historique que représente la création de cette Communauté, ni les espoirs qu’elle offre de libérer l’Europe de la menace de la guerre. La controverse a porté sur le point de savoir si la Grande-Bretagne devait chercher à adhérer à cette Communauté et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Il y a dix semaines, j’annonçais au Parlement que le Gouvernement britannique avait procédé à un examen approfondi et minutieux de l’ensemble du problème des relations de la Grande-Bretagne avec la Communauté Économique Européenne, y compris la question de notre appartenance à l’ A.E.L.E. et au Commonwealth. Chacun des aspects du Traité de Rome lui-même, des décisions prises depuis sa signature et toutes les incidences et conséquences qu’on pouvait s’attendre à voir découler de l’adhésion de la Grande-Bretagne avaient été étudiés en profondeur. A la lumière de cet examen, ajoutais-je, le Gouvernement avait jugé le moment venu de faire une nouvelle ouverture, à un échelon élevé, afin de déterminer si les conditions étaient ou non réunies pour des négociations fructueuses, et sur quelle base ces négociations pourraient avoir lieu.
Et je déclarais à la Chambre des Communes:
«Je veux que la Chambre, le pays et nos amis de l’étranger sachent que le Gouvernement aborde les discussions que j’ai laissé entrevoir avec l’intention bien déterminée et la ferme résolution d’entrer dans la Communauté Économique Européenne si, comme nous l’espérons, il se révèle possible de sauvegarder les intérêts essentiels de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Nous parlons sérieusement.»
Telle est, Monsieur le Président, notre position. Nous parlons sérieusement. Et je vais vous dire pourquoi nous parlons sérieusement.
Nous parlons sérieusement parce que nous sommes convaincus que l’adhésion de la Grande- Bretagne et la participation d’autres pays membres de l’A.E.L.E., sous forme d’adhésion ou d’association, contribueront par elles-mêmes massivement à l’unité et à la puissance économiques de l’Europe. Ce qui est aujourd’hui un marché d’environ 180 millions d’habitants deviendra alors un marché potentiel de près de 280 millions d’âmes – le plus grand parmi tous les pays fortement industrialisés, à l’Ouest comme à l’Est. Et il ne s’agira pas seulement de consommateurs, mais aussi de producteurs: l’adhésion de la plupart ou de la totalité des pays de l’A.E.L.E. apporterait aux communautés existantes non seulement un marché plus vaste, mais aussi le savoir-faire, les qualifications, les connaissances scientifiques et technologiques de millions d’ouvriers et de millions de spécialistes rompus aux raffinements les plus subtils de la technologie moderne.
Nous parlons sérieusement, en outre, parce que la création d’une Communauté économique plus grande et plus puissante servira les intérêts de l’Europe tout entière – les intérêts d’une Europe élargie aussi bien que ceux de l’Europe occidentale, septentrionale et méridionale – tout comme elle servira nos intérêts particuliers. J’ai toujours bien marqué qu’à mon sens le concept d’un puissant partnership atlantique ne pourra se concrétiser que lorsque l’Europe sera à même de mobiliser sa puissance économique pleine et entière, nous mettant ainsi en position de force pour discuter d’affaires industrielles avec nos partenaires atlantiques. Nul ici ne doit douter de la fidélité de la Grande-Bretagne à l’O.T.A.N. et à l’alliance atlantique. Mais j’ai toujours dit aussi que fidélité ne doit jamais signifier servilité. Encore moins doit-elle signifier un servage industriel en vertu duquel nous ne produirions en Europe que l’équipement classique d’une économie moderne, tout en devenant de plus en plus tributaires des grandes sociétés américaines pour l’équipement plus complexe qui fera la loi dans l’industrie au cours des années 70 et 80.
Nous parlons sérieusement dans un sens politique parce que, au cours de l’année à venir, des dix années à venir, des vingt années à venir, l’unité de l’Europe va se forger, et parce que la géographie, l’histoire, l’intérêt et le sentiment tout à la fois commandent que nous contribuions à la forger – et à la façonner.
D’aucuns estiment peut-être que l’élargissement de la Communauté aura pour effet de l’affaiblir ou de diluer le sens qu’elle a de sa mission et de ses institutions. Des changements, il y en aura certes, comme il y en a eu tout au long de ces dix années. Car qui refuse le changement est l’architecte de la décrépitude. La seule institution humaine qui refuse le progrès est le cimetière. Nous entendons, en Europe, contribuer dans toute la mesure de nos moyens à susciter de tels changements, quelles qu’en soient les conséquences pour les intérêts établis ou les tenants du protectionnisme, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ce n’est pas par la stagnation, mais par le mouvement, par un mouvement continuel, que la dynamique créée dans l’Europe d’après-guerre pourra se maintenir, voire s’accélérer. Un élargissement, fondé sur le changement, se traduira donc non pas par un affaiblissement, mais par un renforcement.
J’ai dit que si les conditions voulues peuvent être créées pour une marche en avant décisive et d’une nécessité urgente, la Grande-Bretagne y gagnera. Mais que nul ici ne sous-estime l’apport qu’elle est aussi en mesure de fournir!
Nous apporterons non seulement aux conseils politiques, mais aussi au potentiel industriel de l’Europe, une nouvelle Grande-Bretagne plus résolue, une Grande-Bretagne qui répondra aux brocards écœurants de certains commentateurs non par des paroles, mais par des actes.
Voici les faits: en 1964, lorsque le nouveau Gouvernement britannique est venu au pouvoir, notre déficit était de l’ordre de 800 millions de livres sterling par an. En 1965, il a été ramené à un chiffre inférieur à 320 millions. L’année dernière, malgré un recul momentané dû à une grève dans notre industrie maritime, grève par laquelle le Gouvernement ne s’est pas laissé démonter, malgré la vague de panique monétaire qui a déferlé sur les marchés mondiaux, ce déficit a été de nouveau réduit. Cette année, il sera éliminé et nous comptons arriver progressivement à un excédent.
Nous avons obtenu ce résultat parce que notre Gouvernement n’a pas craint de prendre des mesures impopulaires et que notre peuple s’est montré prêt à accepter ces mesures. Parce que nous avons accordé la priorité à nos exportations et que nos hommes d’affaires ont accepté cette priorité. Parce que nous avons fait passer les investissements et la modernisation avant la vie facile, et que notre peuple sait que nous avons eu raison de le faire. Parce que nous sommes en train de modifier la physionomie et la structure de l’industrie britannique en nous attaquant aux pratiques restrictives en usage chez les employeurs comme chez les travailleurs, tandis que l’industrie elle-même – prenant subitement conscience de l’importance des prix de revient et de l’efficience – fait peau neuve en éliminant de ses conseils d’administration les vestiges trop nombreux de dynasties industrielles qui ont fait leur temps, et en renonçant, dans le domaine de la main-d’œuvre, à des usages hérités d’une génération antérieure de sous-emploi.
J’ai fait allusion à la balance des paiements. Je me permettrai de vous soumettre d’autres chiffres: ceux de la balance commerciale, dont tout le reste dépend. Au cours des cinquante dernières années, la Grande-Bretagne n’a que rarement équilibré sa balance commerciale. Nous avons compté sur les recettes de nos exportations invisibles – autre domaine spécialisé dans lequel nous pouvons contribuer à la plus grande prospérité de l’Europe. Mais, pour ce qui est des échanges directs, le déficit de notre balance commerciale s’élevait en 1964 à 45 millions de livres par mois. En 1965, ce déficit mensuel a été ramené à 23 millions de livres. En 1966, il a été de nouveau réduit de moitié, tombant à 12 millions de livres et, pendant les trois derniers mois de 1966, les mesures prise l’année dernière agissant plus en profondeur sur le problème, nous avons enregistré un excédent égal à plus du double du chiffre le plus élevé jamais atteint en aucun trimestre depuis la guerre, et même du vivant de la plupart d’entre nous.
Outre une économie en cours de renforcement, nous apportons tout ce que la technologie britannique est en mesure d’offrir. Ne soyons pas défaitistes en évaluant l’apport technologique de l’Europe comparé à celui des États-Unis. Chaque pays européens a ses propres arguments à faire valoir. Mais que serait aujourd’hui l’économie industrielle américaine sans l’avion à réaction, directement issu d’une invention britannique mise spontanément à la disposition de nos alliés dans le cadre de notre effort de guerre; sans les antibiotiques – cédés de la même façon; sans la révolution électronique fondée sur la mise au point du radar par la Grande-Bretagne; en fait, sans l’ensemble de la superstructure nucléaire qui doit sa création aux recherches fondamentales de Rutherford et d’autres savants britanniques? C’est là, dira-t-on, chanter notre lot, mais pourquoi pas après tout? Notre tort, à trop d’entre nous en Europe, c’est d’avoir apparemment perdu l’art de nous faire valoir: nos méthodes de vente et nos relations publiques n’ont pas progressé de pair avec nos réalisations technologiques. Mais en rappelant ce que l’Amérique doit aux découvertes européennes d’il y a une génération, il n’est pas question non plus de vivre dans le passé. J’envisage l’industrie américaine d’aujourd’hui dans le contexte des réalisations européennes d’hier qui ont rendu possible son existence. Il nous faut veiller à ce que l’industrie européenne de demain ne devienne tributaire d’une technologie extérieure à l’Europe, avec tout ce que cela peut impliquer en matière de puissance et d’indépendance industrielles. Au cours des deux dernières années, le Gouvernement britannique a, par une politique délibérée, sauvé l’industrie britannique des ordinateurs et sauvegardé son indépendance. C’est en effet la technologie des ordinateurs qui détient la clef de l’avenir. Il convient maintenant d’appliquer le même principe – et pas seulement pour les ordinateurs – à l’échelle européenne.
Telles sont, Monsieur le Président, certaines des raisons pour lesquelles nous parlons sérieusement.
Au début de la tournée que le ministre des Affaires étrangères et moi-même effectuons dans les capitales des Six, on nous demande, à juste titre, quelle est notre position à l’égard du Traité de Rome. Lorsque j’ai fait connaître au Parlement les intentions du Gouvernement le 10 novembre dernier, j’ai précisé que nous serions disposés à accepter le Traité de Rome sous réserve des adaptations nécessitées par l’adhésion d’un nouveau Membre et à condition de recevoir satisfaction sur les points où nous entrevoyons des difficultés.
En prononçant ces paroles, j’avais à l’esprit les dispositions mêmes du traité, qui stipule, en son article 237, que les conditions de l’admission et les adaptations du traité que celle-ci entraîne doivent faire l’objet d’un accord entre les États déjà membres de la Communauté et l’État demandeur.
De toute évidence, il faudra des adaptations au traité pour régler des questions telles que la participation de la Grande-Bretagne aux institutions, avec une représentation appropriée, l’attribution à la Grande-Bretagne d’un nombre de voix approprié au sein du Conseil de Ministres, et d’autres changements encore s’imposeront sans nul doute, comme une révision des quotes-parts que les Etats membres doivent verser au budget et aux fonds de la Communauté. Nous discuterons les diverses difficultés que nous éprouverions à accepter sans réserve certains éléments de la politique élaborée par la Communauté au fil des années. Il est non moins évident, par exemple, que le calendrier selon lequel nous appliquerions diverses dispositions du traité serait différent de celui qui a été prévu dans le traité lui-même, en raison du temps qui s’est écoulé depuis la signature de celui-ci.
Néanmoins, pourvu que les problèmes que nous discernons puissent recevoir une solution satisfaisante, soit au moyen d’adaptations des dispositions prises en vertu du traité, soit de toute autre manière acceptable, le traité lui- même ne constituerait pas un obstacle. Et les règles auxquelles nous aurons apposé notre signature et notre sceau – ces règles nous les respecterons.
Certes, le traité présente des difficultés pour nous, comme il en a présenté pour chacun des signataires originaires. Mais nous bénéficions de cet avantage qu’au cours des dix années écoulées depuis la signature du traité nous avons pu en étudier non seulement le texte, mais aussi le fonctionnement – ce qu’on pourrait appeler le droit jurisprudentiel aussi bien que le droit écrit – et nous sommes encouragés par les résultats de notre étude.
Nous ne sommes pas encore assez avancés dans notre tournée pour tirer des conclusions de nos entretiens. Au terme de notre enquête, il appartiendra au Gouvernement britannique de décider, compte tenu de la meilleure appréciation que nous pourrons porter sur les problèmes qui nous attendent et les chances de les résoudre, si nous sommes fondés à entamer des négociations définitives en vue de notre adhésion. Si telle est notre décision, j’espère que les négociations porteront sur un nombre minimum de questions générales et non sur une infinité de détails. Dans bien des cas, la meilleure manière de régler les détails, de prendre les décisions y afférentes — si importantes soient-elles — sera de les aborder, au fur et à mesure, de l’intérieur de la Communauté. La décision finale même ne saurait être basée sur des calculs économiques minutieusement équilibrés et analysés à l’ordinateur.
Wordsworth écrivit un jour: «... Les cieux condamnent la science De l’homme trop expert en l’art de la balance.»
Je n’entends pas par là que, dans toute négociation à venir, les représentants de la Grande- Bretagne seront des poètes plutôt que des hommes politiques, des économistes et des administrateurs, mais, alors que l’enjeu est si capital pour l’avenir de la Grande-Bretagne, de tous nos pays et de l’Europe elle-même, ce serait une tragédie et une honte que de laisser cette initiative historique s’embourber dans une marécage de détails. Il nous faut maintenir l’élan acquis.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de problèmes majeurs d’une extrême difficulté. Je ne les évoquerai pas ici. C’est une question qu’il vaut mieux réserver pour les entretiens approfondis et confidentiels avec les chefs de gouvernement que nous allons rencontrer durant ces quelques semaines. Néanmoins, je manquerais à toute franchise si je ne faisais pas au moins allusion aux problèmes que posent tout particulièrement les aspects financiers de la politique agricole de ma Communauté, les dispositions qui ont été prises – et à juste titre – pour assurer un dosage juste et équitable entre les intérêts agricoles des six pays en cause, mais qui ne tiennent pas compte – comment d’ailleurs auraient-elles pu en tenir compte? – du problème créé par l’adhésion d’un grand pays importateur de denrées alimentaires comme la Grande-Bretagne. Elles impliqueraient, en effet, une contribution financière qui affecterait de manière fondamentale non seulement l’équilibre si péniblement réalisé il y a deux ans, mais encore l’équilibre de l’équité, aussi bien que celui des paiements, entre, d’une part, la Grande- Bretagne – et les autres pays qui chercheraient à adhérer – et, d’autre part, les six Membres actuels de la Communauté.
Évoquer cette question et être conscient des autres, ce n’est nullement inciter au découragement et encore moins au défaitisme. Il s’agit tout simplement de problèmes à résoudre. Je crois qu’il sera possible de les résoudre si nous les abordons dans cet esprit d’ingéniosité constructive, de tolérance, de compréhension, d’accommodement qui, dès le début, a présidé aux relations des six États membres dans leurs négociations. Car leur solution est nécessaire non seulement dans notre intérêt à tous, mais aussi en considération de tout ce que nous pouvons faire pour éliminer les tensions et créer une unité plus large qui embrasse toute l’Europe, de l’Est comme de l’Ouest; elle est nécessaire – en nous tournant encore davantage vers l’extérieur – eu égard à la contribution que nous pouvons apporter au développement mondial, à la seule guerre que nous souhaitions livrer: la guerre contre la misère et la faim, en raison du rôle que nous pouvons jouer, selon notre génie propre, dans le règlement des problèmes relatifs à cette tension raciale qui envenime de plus en plus les rapports de nation à nation, d’homme à homme.
Je crois encore plus fermement que ces problèmes pourront être résolus si, tout en nous frayant un chemin dans l’enchevêtrement des questions économiques et politiques en jeu, nous gardons tous les yeux solidement fixés sur le dessein par nous proclamé.
Je crois qu’avec cette compréhension, cet esprit d’accommodement et la création des conditions voulues, la tâche dans laquelle nous nous sommes embarqués nous permettra de gagner la bonne volonté et l’appui de la vaste majorité de tous nos peuples. Et elle nous vaudra pardessus tout la bonne volonté et l’appui de la jeunesse de Grande-Bretagne et de celle des autres pays ici représentés aujourd’hui.
Ceux d’entre nous qui se sont vu confier les responsabilités du gouvernement ont pour devoir – devoir ardu mais exaltant – de guider une génération impatiente. C’est une génération impatiente des bavardages, tripotages et grenouillages auxquels s’est ramené trop souvent l’art de gouverner. Elle nous condamnera implacablement et sans appel, comme l’histoire elle- même nous condamnera – car les prochains chapitres de l’histoire seront écrits par cette nouvelle génération – si nous ne savons pas mettre à profit cette bouillonnante et irrésistible marée qui, comme tant d’entre nous l’ont nettement perçu, déferle à nouveau dans les affaires des hommes. Si nous échouons – je veux que vous le compreniez bien – ce ne sera pas la faute de la Grande-Bretagne. Mais le prix de cet échec, et surtout le prix des occasions manquées, c’est chacun de nous qui devra, et dans une mesure croissante, le payer.
J’ai commencé par évoquer les thèmes essentiels de l’histoire de l’Europe il y a un siècle et aujourd’hui. Au cours du siècle dernier, la création des États-nations d’Europe a exigé des citoyens de ces États le sacrifice de leur vie. Durant notre siècle, l’avenir de l’Europe et du monde, a imposé à deux reprises qu’une génération donne sa vie pour la défense de la liberté. L’Europe d’aujourd’hui, l’Europe qu’il est en notre pouvoir de façonner, avec tout ce que cela implique pour un monde plus vaste, n’exige aucun sacrifice héroïque de ce genre. Tout ce que l’on demande à la génération actuelle, c’est de sacrifier de prétendus intérêts immédiats, des préjugés à courte vue et des formes de pensée stéréotypées. Je suis convaincu qu’elle a fait son choix.
Monsieur le Président, je vous remercie. (Applaudissements.)
M. MONTINI (Italie) (traduction)
Traduction de l’italien
Monsieur le Président, en ma qualité de membre ancien et de premier Vice-Président de notre Assemblée, je tiens à remercier chaleureusement M. le Premier Ministre Wilson d’avoir participé à notre Assemblée pour nous exposer le point de vue de son Gouvernement sur un problème concernant au plus haut point le Conseil de l’Europe: la place et le rôle de la Grande-Bretagne dans le cadre de l’intégration européenne.
Je saisis l’occasion, Monsieur le Président, pour souhaiter le plus grand succès à l’action entreprise par M. le Premier Ministre et à sa tournée européenne. Bien que son exposé ait déjà largement envisagé ce point, je voudrais demander à M. Wilson si l’Angleterre est favorable à un développement de la coopération européenne à l’échelon politique, voire institutionnel et politique, ce qui pourrait mener à une nouvelle et plus substantielle intégration dépassant le stade éminemment économique et exécutif qui caractérise l’activité des organismes actuels, y compris les États de la Communauté Économique.
Merci, Monsieur le Président.
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Je tiens à remercier le Vice-Président, M. le sénateur Montini, de sa déclaration et de ses vœux de succès.
Je répondrai à sa question que, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous n’envisageons pas l’évolution future des relations de la Grande- Bretagne avec l’Europe et à l’intérieur de celle-ci uniquement d’un point de vue économique, limité à la Communauté telle qu’elle existe actuellement, mais aussi du point de vue politique.
Quant à l’évolution des institutions et aux relations entre les Membres de la Communauté élargie, c’est là une question dont j’ai actuellement le privilège de discuter avec les gouvernements au cours de la tournée dont je vous ai parlé. Monsieur le sénateur n’ignore sans doute pas que j’ai eu la semaine dernière à Rome des entretiens très utiles et instructifs à ce sujet.
Nous entendons nous conformer, dans la lettre et dans l’esprit, aux institutions qui pourront être créées d’un commun accord entre les Membres de la Communauté, dont nous-mêmes. Toutefois, aussi longtemps que notre pays ne sera pas Membre de la Communauté, il vaut peut-être mieux que moi-même ou mes collègues britanniques nous abstenions de prendre position sur des sujets qui ont fait ou qui font encore l’objet de discussions entre les Six. Si nous entrons dans la Communauté, nous apporterons notre entier concours à l’étude de ces problèmes.
Sir Alec DOUGLAS-HOME (Royaume-Uni) (traduction)
J’ai souvent l’occasion de poser des questions au Premier Ministre, mais rarement quand je suis à l’étranger! Qu’il me permette de lui dire aujourd’hui que les membres conservateurs de la délégation britannique à cette Assemblée appuient sans réserve son initiative actuelle et que, dès lors, le mouvement en faveur de l’adhésion à la Communauté Européenne peut désormais être envisagé dans le contexte d’une large union nationale en Grande- Bretagne. J’adresse, en particulier, au Premier Ministre mes meilleurs vœux de succès pour les importants entretiens qu’il va avoir à Paris.
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Je tiens à remercier Sir Alec Douglas-Home de sa déclaration et à confirmer que, comme il l’a rappelé, l’initiative annoncée devant la Chambre des Communes par le Gouvernement de Sa Majesté a reçu dès l’origine, de la part des principaux partis représentés à la Chambre, un appui sans réserve qui ne s’est pas démenti depuis lors. Je le remercie également des vœux qu’il a formulés pour la suite de notre tournée.
M. RADIUS (France)
Monsieur le Premier Ministre, vous avez évoqué tout à l’heure le problème créé par l’adhésion éventuelle de la Grande-Bretagne, en tant que grand pays importateur de denrées alimentaires. Vous vous êtes référé à deux reprises à votre déclaration d’il y a dix semaines, faite le 10 novembre de l’année dernière, dans laquelle vous avez insisté sur les intérêts essentiels de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.
Le 4 mai, vous avez été un peu plus précis. Dans une réponse au leader du parti libéral, vous avez déclaré:
«La politique agricole commune signifierait un prélèvement de 65 à 70 % sur les importations de céréales du Commonwealth. Le Gouvernement estime de façon nette qu’il n’est pas possible d’accepter cela. Si la politique agricole était modifiée pour rendre la chose plus acceptable, la position serait différente.»
C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, je vous demande de me permettre de vous poser la question suivante: pensez-vous toujours aujourd’hui la même chose, et envisagez-vous comme un intérêt essentiel de la Grande-Bretagne et du Commonwealth la modification de la politique agricole commune de façon à diminuer le prélèvement sur les céréales importées?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Il s’agit là d’une question extrêmement importante et complexe et je crois, comme vous tous sans doute, qu’elle pourrait peut-être être discutée plus tard de façon plus fructueuse qu’aujourd’hui.
Elle a d’ailleurs déjà donné lieu à des échanges de vues extrêmement profitables à Rome et je suis convaincu qu’il en sera de même à Paris, à Bruxelles, à La Haye, à Bonn et à Luxembourg.
J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de répondre, à des questions qui m’étaient posées sur ce problème des prélèvements, que, si l’on se place dans la perspective des années 1969, 1970 et des années suivantes, il est difficile de prévoir avec quelque exactitude l’incidence que les prélèvements auront sur la balance des paiements britannique et de faire le moindre pronostic précis sur leur coût ou même sur leur ampleur, car je n’ai jamais encore rencontré un professionnel de l’agriculture capable de dire à coup sûr si les prix mondiaux n’augmenteront pas pendant cette période; je ne pense pas non plus que l’on puisse affirmer avec certitude ce que seront alors les prix de la Communauté. Je pense que ces questions pourront faire l’objet de discussions ultérieures.
Il s’agit là d’un problème très important pour nous ainsi que pour la Communauté; il revêt une importance particulière pour les pays qui sont de gros importateurs de denrées alimentaires.
Dans la déclaration que j’ai faite il y a quelques minutes, j’ai particulièrement insisté sur les problèmes des règlements financiers envisagés du point de vue de l’emploi des fonds que les gouvernements perçoivent au titre des prélèvements. L’adhésion d’un gros importateur de produits alimentaires rendrait naturellement caducs tous les chiffres qui ont été calculés au cours de ces deux dernières années – au prix, je crois, de difficultés considérables, de discussions ardues et de nombreuses séances de nuit; cette adhésion entraînerait, bien entendu, une augmentation du chiffre global actuellement prévu pour les ressources à affecter au Fonds spécial.
C’est pourquoi ces questions devraient, comme le prévoit d’ailleurs le traité lui-même, donner lieu à des adaptations pour tenir compte de l’adhésion d’un nouveau Membre. J’espère que, grâce à ces adaptations, nous pourrons les résoudre à notre avantage mutuel.
Je dirai à notre ami – qui est plus qu’un ami puisque, dans un sens politique très particulier, il est notre hôte en sa qualité de représentant au Parlement de la ville où nous sommes réunis – que si l’on étudie de façon attentive et approfondie, comme il l’a certainement fait, l’ensemble du problème du commerce des céréales, on est tenté de conclure que certaines modifications de prix pourraient être très profitables pour son pays, et peut-être même pour sa propre circonscription, et donner naissance à des échanges commerciaux plus étroits et plus actifs entre la Grande-Bretagne et la France. Il n’y a d’ailleurs pas forcément une seule façon de concevoir et de résoudre tous ces problèmes.
M. STRUYE (Belgique)
Monsieur le Premier Ministre, je m’excuse si mes questions sont indiscrètes, mais vous savez que les parlementaires sont toujours curieux et parfois indiscrets. Voici ma première question: estimez-vous que les difficultés qui s’opposent encore à la réussite de vos démarches, dont nous sommes unanimes à souhaiter qu’elles aboutissent, sont d’ordre économique ou d’ordre politique?
Ma seconde question se rattache à celle de M. Radius et a trait à la politique agricole. Après bien des difficultés, les Six sont arrivés à établir les lignes générales d’une politique agricole commune. Vous avez indiqué les difficultés qui se présentent en Grande-Bretagne et que nous connaissons tous. Puis-je vous demander si vous pensez qu’elles pourraient être résolues uniquement par des mesures très larges de transition et d’adaptation progressive qui ne changeraient rien aux principes déjà adoptés par les Six?
Ma troisième question est la suivante: les Six ont eu entre eux de grosses difficultés, qui ont été résolues il y a à peu près un an jour pour jour, à Luxembourg, à propos de la majorité qualifiée. Sans modifier le Traité de Rome, ils sont arrivés à une sorte de gentlemen’s agreement qui tendait à assortir dans la pratique, sur un plan pragmatique, l’application de cette majorité qualifiée de mesures et de garanties qui la rendraient plus acceptable pour chacun des pays. Le Premier Ministre peut-il nous dire s’il estime que cette voie pourrait conduire la Grande-Bretagne à adhérer à ce qui a été convenu au sujet de la majorité qualifiée?
Quatrième question: on a beaucoup parlé de l’ancien plan Fouchet-Catani. Le Premier Ministre pense-t-il que ce plan pourrait être dans les prochains mois la base d’un nouvel effort en vue de la relance d’un début d’union politique de l’Europe, et que la Grande-Bretagne serait disposée à s’y associer?
Enfin, toute dernière question: nous croyons tous, je pense, nous l’avons affirmé cent fois dans cette Assemblée, que l’Europe de demain ne peut pas se concevoir sans l’adhésion à part entière de la Grande-Bretagne, qui fait partie intégrante de l’Europe; mais si le malheur voulait que cette étape ne pût être franchie dans les mois qui viennent, M. le Premier Ministre estime-t-il possible d’envisager, à titre subsidiaire, conformément aux derniers articles du traité, un traité d’association qui serait une première étape vers une adhésion future?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Je vais répondre brièvement à ces cinq questions.
M. Struye m’a d’abord demandé si, à mon sens, les difficultés que soulève l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté étaient surtout d’ordre économique ou d’ordre politique. S’il fait allusion aux difficultés qui existent de notre côté, l’adhésion de la Grande-Bretagne soulève pour nous, comme je l’ai déjà dit, un certain nombre de problèmes d’ordre économique, mais elle ne pose pas de problème politique. Si, en revanche, M. Struye me demande de prévoir les difficultés qui pourraient surgir du côté des Six, je répondrai qu’il vaudrait peut-être mieux laisser cette question en suspens pendant quelques semaines encore, c’est-à-dire pendant la durée des entretiens exploratoires, ou, peut-être, que M. Struye et son Gouvernement sont sans doute mieux placés que moi pour faire des pronostics à ce sujet.
La deuxième question a trait à l’agriculture. M. Struye me demande si, d’après moi, la question agricole peut être résolue simplement par l’aménagement de certains délais – par l’adoption de mesures de transition – ou s’il faudra apporter des modifications plus profondes aux principes déjà adoptés. Nous nous penchons déjà sur ce problème au cours de la tournée que nous effectuons actuellement. Nous n’avons eu jusqu’ici l’occasion d’en discuter que dans une seule capitale, Rome. Le Secrétaire du Foreign Office et moi-même avons retiré une impression très encourageante de ces entretiens, car nous avons eu le sentiment que certaines difficultés prévues dans le domaine agricole se révéleraient peut-être moins graves que nous ne le pensions. Toutefois, il y aura naturellement des problèmes à résoudre à propos des règlements financiers, qui, comme je l’ai dit, devraient en tout état de cause être remaniés de façon à tenir compte de l’adhésion d’un nouveau Membre. Il est évident que les pourcentages actuels devront être modifiés si le nombre des participants augmente.
Je ne pense pas que ces problèmes soient insolubles. Je crois simplement qu’ils sont délicats et que nous pourrons les résoudre à condition que chacun fasse preuve de la bonne volonté requise.
La troisième question concerne la majorité qualifiée et les discussions de Luxembourg. Nous avons suivi avec le plus grand intérêt les discussions que les Six ont eues sur ces problèmes au cours des deux dernières années. Nous avons jugé qu’il n’appartenait pas au Gouvernement ou au Parlement britannique d’intervenir dans le cours de ces discussions puisqu’elles ne nous concernaient pas directement. J’imagine que l’on nous aurait priés de nous mêler de nos propres affaires si nous avions exprimé un avis quelconque sur ces discussions.
Si nous entrons dans la Communauté, il va sans dire que nous prendrons activement part à toutes les discussions futures. À partir du moment même de notre adhésion, nous appliquerons tous les accords conclus entre les pays qui ont fondé la Communauté et qui l’ont fait fonctionner depuis lors.
Si vous me permettez de m’étendre encore un peu sur cette question, je rappellerai que, comme je l’ai indiqué dans mon exposé, nous nous sommes efforcés d’étudier non seulement la lettre du traité, mais aussi la façon dont il a fonctionné dans la pratique. J’ai dit qu’à cet égard nous étions parvenus à des conclusions encourageantes. Les discussions qui ont eu lieu à Luxembourg et leurs résultats ont fort bien pu compter parmi les éléments qui nous ont amenés à de telles conclusions.
La quatrième question qui m’a été posée concerne l’avenir politique de l’Europe. Mon interlocuteur a mentionné à titre d’exemple le plan Fouchet, que nous avons évidemment étudié. Je crois là encore que, le problème étant un sujet de controverse entre les Six, il ne m’appartient pas d’exprimer, ex abrupto ou non, un avis en faveur de telle ou telle formule. Si, en effet, de nombreux hommes d’État européens ont consacré une grande part de leur temps et de leurs réflexions à l’unité politique de l’Europe, ils sont jusqu’à présent parvenus à des conclusions divergentes sur ce problème.
Si l’on me demande – et on me l’a effectivement demandé – si j’ai l’espoir que l’on pourra dans quelques mois parvenir à un accord sur le plan Fouchet ou sur toute autre formule, je ne peux, là encore, que renvoyer mon interlocuteur à ceux qui discutent ces problèmes depuis dix ans. Pendant ces dix années, aucun accord n’a pu être réalisé, et cela est regrettable. Il ne m’appartient pas, je pense, à moi qui vois les choses de l’extérieur, de dire que nous pourrons réaliser dans dix mois un accord qui ne l’a pas été en dix ans.
Cependant, nous ferons avec vous tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à une solution, car l’unité politique future de l’Europe nous concerne tous. Je vais même exprimer une opinion qui, je crois, ne sera pas partagée par tout le monde ici en disant que si, comme nous l’espérons, des discussions s’engagent sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté, nous souhaitons être associés le plus tôt possible aux discussions relatives à l’unité politique afin de pouvoir y apporter notre contribution avant même que les questions économiques et autres soient réglées.
La cinquième question concerne l’association. Je sais que les grandes difficultés que soulève incontestablement l’adhésion aux termes de l’article 237 – difficultés que nous aurions tort de minimiser ou de chercher à dissimuler – ont amené une partie de la presse à suggérer le recours à un traité d’association aux termes de l’article 238. Il ne m’appartient pas de tenter de définir la forme de liens que nos partenaires de l’A.E.L.E. auraient intérêt à établir avec la Communauté. Chacun d’eux jugera par lui- même du type d’association qui lui convient le mieux. Il ne m’appartient même pas de faire des conjectures sur la décision finale qu’ils adopteront.
Certains, je le sais, voudront être Membres à part entière; d’autres souhaiteront, je crois, avoir le statut de Membre associé. Encore une fois, je n’ai pas qualité pour faire des spéculations à ce sujet. Ce serait cependant, à mon sens, faire preuve d’un défaitisme singulier que d’envisager dès maintenant, en raison des difficultés à résoudre, la demi-solution qui consisterait pour la Grande-Bretagne à devenir Membre associé de la Communauté – c’est-à-dire à entretenir des liens assez lâches avec une organisation dans laquelle nous devrions, si tout se passe bien, être pleinement intégrés.
Il n’est pas non plus dans notre tempérament d’adhérer à une organisation avec laquelle nous n’aurions que des liens lâches et dans le fonctionnement de laquelle nous n’aurions pas notre mot à dire. Non, c’est peut-être là une mauvaise échappatoire aux difficultés qui se présentent à nous. Je préférerais que nous nous attaquions tous directement à ces difficultés et que nous cherchions sans détours une solution aux problèmes que nous avons à surmonter.
M. Finn MOE (Norvège) (traduction)
Je tiens d’abord à m’associer à mes collègues qui ont félicité M. Wilson de sa brillante allocution. La question que je veux poser n’est pas de caractère économique, mais elle n’en a pas moins une incidence importante sur les négociations qui, nous l’espérons tous, aboutiront à une plus grande unité économique en Europe.
J’ai lu dans la presse que le Premier Ministre du Royaume-Uni acceptait l’idée de ce qu’on a appelé un système de défense atlantique à deux piliers. Est-ce exact?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Je suis toujours heureux d’entendre les avis, les commentaires ou les questions de mon vieil ami M. Finn Moe, et je le remercie de ce qu’il vient de dire. Il a mentionné une expression ou notion qui revient très souvent, je crois, dans les discussions consacrées à ces problèmes – la notion de deux piliers jumeaux situés de part et d’autre de l’Atlantique. En réalité, je crois que cette expression est généralement utilisée non pas dans le contexte de la défense atlantique, mais dans la perspective plus large du partnership atlantique. L’idée de base est que ce partnership ne peut être réel que s’il est fondé sur l’indépendance tout autant que sur l’interdépendance, dans des conditions telles que les deux parties puissent discuter sur un pied d’égalité, ce qui implique un renforcement du partenaire européen.
Pour autant que la notion en question vise le renforcement de la puissance économique, technique et industrielle de l’Europe, j’ai déjà dit dans mon exposé que nous la faisions entièrement nôtre. Notre conception d’un partnership atlantique exclut la subordination ou la dépendance à l’égard d’une technologie étrangère. On a souvent utilisé l’expression: «piliers jumeaux»; la plupart des orateurs à la Chambre des Communes l’emploient comme je l’ai fait moi-même. Cependant, lorsqu’on a recours à des images, il faut se garder de se laisser entraîner trop loin par elles. Cette expression a fini par devenir un véritable cliché dans cette sorte de discussion. Étant moi-même le roi du cliché à la Chambre des Communes, je serais le dernier à reprocher à quiconque d’y avoir recours, d’autant plus que je l’ai utilisée moi-même; il faut cependant la manier avec une extrême prudence.
Si cette image des deux piliers jumeaux signifie que nous devons développer nos propres ressources techniques pour parvenir à l’équilibre des forces, j’estime que nous pouvons tous y avoir utilement recours.
M. VOS (Pays-Bas) (traduction)
Monsieur le Président, vous avez établi comme règle que seul le Président de la commission politique peut poser plusieurs questions, mais non pas le Président de la commission économique. Je m’y conformerai donc.
Je souhaite à M. Brown que son voyage dans toutes les capitales européennes soit couronné de succès. Lorsqu’il arrivera à La Haye, nos élections auront eu lieu.
Au Parlement Européen, nous sommes toujours amenés à aborder la question du droit de contrôle sur les aspects financiers de la politique agricole. J’aimerais demander à Monsieur le Premier Ministre du Royaume-Uni si, lors des conversations qu’il aura avec les autres chefs de gouvernement ou chefs d’État au cours du mois prochain, il compte discuter de la question des droits et prérogatives du Parlement dans les cas où le fonctionnement de la Communauté a d’importantes incidences financières. Cette question des prérogatives et des droits du Parlement Européen vis-à-vis de la Commission et du pouvoir exécutif de la Communauté sera-t-elle à l’ordre du jour des conversations de M. Wilson?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
J’ai souvent eu l’occasion de discuter de ces problèmes en commission avec M. Vos au cours des dernières années. C’est un plaisir pour moi que de l’entendre évoquer de nouveau ce sujet.
Si je comprends bien sa question, il fait allusion non pas au contrôle des parlements nationaux, mais à celui du Parlement Européen sur le fonctionnement du programme et de la politique agricoles, notamment sur les aspects financiers de cette politique, étant donné qu’il est de tradition dans chacun de nos pays que le parlement exerce son contrôle sur le budget.
M. Vos m’a demandé si cette question jouait un rôle dans nos discussion avec les chefs de gouvernement des six pays de la Communauté Économique Européenne. La réponse est, bien entendu, que M. George Brown et moi-même ferons de notre mieux pour répondre à toute question que le chef de tel ou tel gouvernement souhaiterait nous poser. Pour notre part, nous soulignerons les difficultés qui doivent être soulignées, tout comme les éléments favorables que nous discernons. Nous chercherons également, comme nous l’avons fait à Rome, à recueillir auprès des principaux pays des enseignements sur le fonctionnement pratique de la Communauté, afin de pouvoir surmonter les difficultés.
L’évolution future du contrôle parlementaire est une question qui relève de la compétence des Six. Elle ne se pose pas dans l’immédiat et n’a donc pas à être tranchée. Si nos négociations nous permettent d’entrer dans la Communauté Européenne, nous prendrons, en notre qualité de Membre de cette Communauté, une part active à la discussion de tous ces problèmes au même titre que nos partenaires. Je pense que tant que nous n’en sommes pas membres, il serait erroné de notre part de vouloir aller plus vite et plus loin que les pays qui en font déjà partie. Il serait cependant tout aussi erroné de croire qu’une fois devenus membres, nous pourrions rester à la traîne par rapport aux Six dans tel ou tel domaine où ils se seraient mis d’accord.
M. LE PRÉSIDENT (traduction)
Je tiens à préciser à M. Vos que le Bureau ne fait aucune différence entre les commissions ni entre leurs Présidents. Il s’est trouvé que M. Struye est intervenu à l’ouverture du débat politique et je l’ai autorisé à poser cinq questions.
La parole est à M. Badini Confalonieri.
M. BADINI CONFALONIERI (Italie)
Monsieur le Premier Ministre, je vous poserai une seule question.
Vous avez bien voulu tout à l’heure dans votre réponse vous référer à votre visite à Rome la semaine passée. La visite à Rome est la première de votre tournée européenne. Chez nous, on dit qu’un bon début c’est déjà la moitié de l’œuvre.
M. le Premier Ministre pourrait-il nous donner l’impression qu’il a tirée de cette visite?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Comme je l’ai dit avant de quitter Rome aux journalistes présents, j’estime que cette visite a été un excellent point de départ pour notre tournée européenne. Le Gouvernement italien nous a réservé un accueil très chaleureux – plus chaleureux encore que nous l’escomptions – et il nous a assurés de son appui total dans l’accomplissement du dessein que nous nous sommes fixé. Grâce à sa vaste expérience des affaires de la Communauté, il nous a beaucoup aidés à comprendre comment divers problèmes qu’il devait affronter ont été résolus, par exemple dans le domaine de la politique d’aménagement du territoire, qui est un problème particulier à l’Italie, mais qui se pose également pour certaines régions du Royaume-Uni.
Nous avons pris un excellent départ. Je pourrais dire qu’à un certain moment, après un échange de vues prolongé, M. Fanfani m’a posé d’affilée pas moins de quinze questions et que je me suis efforcé de lui donner, avec la même rapidité et la même netteté, quinze réponses. Quant à savoir s’il en a été satisfait, je suis sûr que vous l’apprendrez à Rome.
M. DUNNE (Irlande) (traduction)
Dans son discours très éloquent et fort encourageant, le Premier Ministre a mentionné les Celtes; or, j’en suis un.
J’aimerais donc poser au Premier Ministre cette question: voudrait-il dire un mot des perspectives d’une unification de l’Irlande dans le cadre d’une Communauté Économique Européenne élargie?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Ce n’est pas une question nouvelle pour moi! Je suis heureux de dire à M. Dunne, si cela peut le réconforter, que je représente deux fois plus d’Irlandais à la Chambre des Communes britanniques qu’il n’en représente lui-même au Dail! Il a eu l’obligeance de ne pas rendre cette question plus difficile pour moi en la posant en irlandais, aussi ne répondrai-je pas pour ma part en argot de Liverpool – qu’il connaît, j’en suis sûr!
Cette question n’entre pas vraiment dans le cadre du Traité de Rome ni même dans celui d’aucune discussion relative à ce traité. Son origine est beaucoup plus ancienne et elle pose, à sa manière, des problèmes non moins épineux que ceux que doivent affronter les Membres de la Communauté Économique Européenne.
Je pense, pour ma part, que nous sommes nombreux au Parlement britannique à avoir été assez favorablement impressionnés, au cours des deux dernières années, par l’amélioration des relations internes en Irlande qui a fait suite aux consultations intervenues entre M. Lemass, quand il était «Taoiseach» – j’espère avoir prononcé ce mot correctement – et le Premier Ministre d’Irlande du Nord, M. O’Neill. Je crois qu’ils ont agi l’un et l’autre en véritables hommes d’État en se rencontrant à un moment où une telle initiative risquait d’être critiquée par les électeurs des deux côtés de la frontière.
Je suis heureux de signaler que M. Lynch, le nouveau «Taoiseach», et M. Terence O’Neill ont tous deux discuté cette question avec moi à Downing Street durant les quatre ou cinq dernières semaines. Je crois que la signature, l’année dernière, du Traité de libre-échange entre la Grande-Bretagne et la République d’Irlande facilitera automatiquement la réalisation d’une union économique plus étroite entre les deux parties de l’Irlande. Ce traité assurera en effet, avec le temps, une liberté complète des échanges entre l’ensemble des Îles britanniques, et la frontière – qui a été le théâtre d’événements historiques si intéressants que je ne crois pas nécessaire de les rappeler aujourd’hui – va ainsi s’ouvrir au commerce entre l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud.
Je crois, Monsieur le Président, que la question principale ne peut être tranchée dans le cadre du Traité de Rome. Si le Conseil de l’Europe ne peut résoudre le problème, je doute que la Communauté Économique Européenne soit, à elle seule, en mesure de le faire. A vrai dire, je ne crois pas qu’aucun de nous le puisse, sauf les Irlandais eux-mêmes: c’est au peuple irlandais qu’il appartient de trouver une solution. Je sais, tout comme mes prédécesseurs, que nul ne serait plus heureux que la Grande-Bretagne si cette question était réglée par un accord à l’intérieur de l’île d’Émeraude. Je suis sûr d’exprimer la pensée de chacun en formulant l’espoir que nous assisterons dans le proche avenir à l’accélération du processus de rapprochement amorcé au cours des trois ou quatre dernières années.
M. LE PRÉSIDENT (traduction)
J’espère que M. Dunne sera encouragé par le fait que le Premier Ministre n’a pas seulement parlé de l’île d’Émeraude, mais qu’ayant prévu sa question, il porte une cravate aux couleurs irlandaises.
M. POUNDER (Royaume-Uni) (traduction)
Tout en regrettant que M. Dunne ait cru bon de saisir cette occasion pour faire de la propagande nationaliste irlandaise, puis-je demander au Premier Ministre de bien vouloir confirmer que le Gouvernement de Sa Majesté a toujours l’intention de s’en tenir à la Loi sur l’Irlande de 1949 aux termes de laquelle il appartient au peuple de l’Irlande du Nord de décider de son propre destin constitutionnel et de conserver des liens avec le Royaume-Uni aussi longtemps qu’il le désirera?
M. Wilson, Premier ministre du Royaume-Uni (traduction)
Je ne suis pas sûr que les questions qui me sont normalement posées à la Chambre des Communes, et auxquelles je ne manque jamais de répondre, devraient occuper le temps de cette Assemblée. Je confirme cependant que la réponse que j’ai donnée à la Chambre des Communes à plusieurs éminents collègues nord-irlandais de M. Pounder demeure valable. Il n’en reste pas moins qu’à mes yeux le véritable devoir de tous les Irlandais du Nord et du Sud est de chercher ensemble, sans esprit partisan et avec la volonté sincère d’aboutir, une solution à leur problème, afin que nous puissions les féliciter de tout cœur de l’avoir résolu et être enfin dispensés à l’avenir de répondre à toutes ces questions.
M. LE PRÉSIDENT (traduction)
Je crois qu'il me faut maintenant clore cette période réservée aux questions et aux réponses. Deux membres de notre Assemblée m'ont fait parvenir depuis le début de la séance des notes écrites pour m'informer qu'ils ont des questions à poser. Je regrette qu'il ne soit pas possible de le faire dans le temps qui nous est imparti. Je veillerai cependant à ce que les intéressés aient la priorité dans le débat.
Monsieur Wilson, je tiens à vous remercier très sincèrement, au nom de l'Assemblée, non seulement d'être venu ici pour y prononcer un discours, mais aussi d'avoir répondu aux questions que nous vous avons posées. Je vous en remercie vivement.