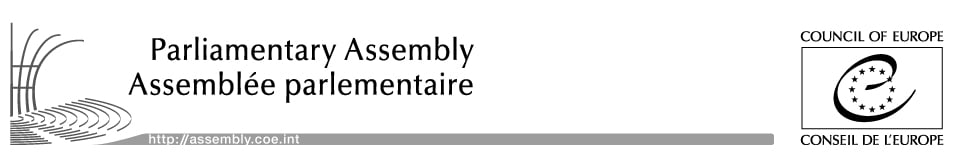Paul-Henri
Spaak
Ancien Premier ministre de Belgique et ancien Président de l'Assemblée
Discours prononcé devant l'Assemblée
mardi, 11 décembre 1951

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je n’entends pas du tout essayer, soyez-en sûrs, de profiter de l’occasion qui m’est offerte pour prononcer un discours. Je crois, d’ailleurs, que, ce matin, j’en serais bien incapable. Je veux seulement tenter – et vous me le permettrez sans doute – d’apporter quelques considérations d’ordre général, qui, je l’espère, seront brèves, pour justifier le vote affirmatif que je donnerai à l’amendement de MM. Teitgen et de Menthon, comme je suis décidé à donner un vote affirmatif à toute motion qui fera sortir le Conseil de l’Europe de la période de négativisme et de stagnation dans laquelle il est entré, et comme j’aurais donné hier, bien que n’ayant jamais été moi-même fédéraliste, mon vote à la motion de M. de Félice, dans le même esprit et avec la même volonté.
Mesdames, Messieurs, du haut du fauteuil que j’occupais jusqu’à hier, j’ai fait une constatation qui, souvent m’a rempli d’une bien grande tristesse. J’ai été étonné de la somme de talents que l’on dépensait dans cette Assemblée, pour expliquer qu’il ne fallait pas faire quelque chose. Aujourd’hui, chacun a sa bonne raison de rester sur place. Certains Allemands ne feront l’Europe que lorsqu’ils auront réalisé l’unité de l’Allemagne. Certains Belges ne feront l’Europe que quand l’Angleterre y aura donné son adhésion. Certains Français ne feront pas l’Europe si on les place en présence des Allemands dans un dialogue. Les. Anglais ne feront pas l’Europe aussi longtemps qu’ils n’auront pas réalisé une solution acceptable avec le Commonwealth. Nos amis scandinaves assistent à tout cela, me semble-t-il, d’un air assez désabusé et assez désintéressé.
J’ai la conviction que si, dans cette. Assemblée, on dépensait le quart de l’énergie que l’on met à dire non pour dire oui à quelque chose de positif, nous ne serions plus déjà dans l’état où nous sommes aujourd’hui. (Applaudissements.)
Je suis convaincu, mon cher collègue, de votre complète sincérité; mais ce dont je suis également convaincu, c’est que lorsque vous dites «je suis un bon Européen» ce n’est évidemment pas la même chose que lorsque je le dis moi-même.
J’ai fait une autre constatation, celle-là plus grave et plus douloureuse au cours de cette dernière Session. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais froisser personne, je voudrais employer les termes parlementaires les plus convenables, mais j’ai acquis la conviction que, dans cette Assemblée, il n’y a pas plus de soixante membres qui croient vraiment à la nécessité de faire l’Europe. Bien sûr, tout le monde dit: «Je suis un bon Européen» et M. Gordon Walker le disait hier encore, avec un peu d’irritation, répondant à un discours de M. Paul Reynaud. Je lui dis tout de suite: je suis convaincu, mon cher collègue, de votre complète sincérité; mais ce dont je suis également convaincu, avec la même et profonde conviction, c’est que lorsque vous dites «je suis un bon Européen» ce n’est évidemment pas la même chose que lorsque je le dis moi-même. Nous voyons les choses de manières tout à fait différentes. S’il n’y avait pas quelque prétention à m’exprimer ainsi, je vous dirais que notre perspective historique actuelle n’est pas semblable.
J’ai l’impression – j’exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup – qu’un certain nombre de nos collègues viennent ici en se posant la question: «Ce que nous faisons, est-ce très utile?» Je me demande moi-même s’ils ne pensent pas: «Est-ce très intéressant?»
Or, voyez-vous, c’est là que nos points de vue diffèrent du tout au tout. Alors que certains sont à peine touchés par l’intérêt et l’utilité de notre besogne, certains autres considèrent ce que nous aurions à faire comme une chose vitale et d’une urgente nécessité.
J’admire ceux qui peuvent rester calmes dans l’état actuel de l’Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n’étions forcés d’être si parlementaires. Mais, tout de même, retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s’écouler, demandez-vous ce que l’Europe était encore il y a cinquante ans! Je ne vous demande pas de remonter au temps de sa grande splendeur. Les hommes, qu’ils viennent de Rome, d’Athènes, de Paris ou de Londres, qui doivent se souvenir de ce que leurs pays ont été et de ce que leurs capitales ont représenté dans le monde et qui mesurent aujourd’hui ce que nous sommes tous devenus, comment peuvent-ils montrer ce calme et cette sérénité devant les événements?
L’Europe dont nous parlons ici, c’est une Europe que nous avons d’abord laissé gravement mutiler. Plus de Pologne, plus de Tchécoslovaquie, plus de Hongrie, plus de pays balkaniques, plus d’Allemagne de l’Est. L’Europe dont nous parlons ici, c’est une Europe contre laquelle, aujourd’hui, se révoltent aussi bien l’Asie que l’Afrique, et le plus grand et le plus puissant d’entre nous, encore aujourd’hui, se voit bravé en Iran et en Égypte. L’Europe dont nous parlons aujourd’hui, c’est une Europe qui, depuis cinq années, vit dans la peur du Russe et de la charité des Américains!
Devant un tel spectacle, nous sommes impassibles, comme si l’histoire attendait, comme si nous avions le temps, tranquillement, au cours de dizaines et de dizaines d’années, de transformer notre mentalité, de supprimer nos barrières douanières, d’abandonner nos égoïsmes nationaux, comme si nous avions l’éternité devant nous.
Voilà, Messieurs, le conflit fondamental qui existe dans cette Assemblée. Nous croyons que faire l’Europe est une besogne vitale si nous voulons sauver ce vieux continent, aussi bien la Grande-Bretagne que les autres pays. Beaucoup d’entre vous nous donnent l’impression de ne pas y penser. M. Gordon Walker dit: «Je suis bon Européen, je vous assure vouloir collaborer avec vous», mais que nous a-t-il dit à maintes reprises au cours de cette quinzaine? Ceci: «Eh bien, travaillons ensemble, soutenons les accords gouvernementaux, tâchons de les faire plus nombreux et meilleurs!»
C’est peut-être une façon de faire l’Europe, bien que je ne voie pas très clairement ce que cela signifie. Mais vous imaginez-vous vraiment que, pour soutenir les accords gouvernementaux il ait été utile de bâtir ce palais et de réunir deux fois par an deux cents députés de l’Europe? Ne croyez-vous pas que les gouvernements sont capables de promouvoir des accords gouvernementaux sans notre aide? Quand vous parlez des accords gouvernementaux les plus intéressants qui ont été conclus au cours de ces dernières années, vous citez l’O.E.C.E. et l’U.E.P. dans lesquels notre Assemblée n’a eu absolument rien à faire.
Si, vraiment, c’est cela la collaboration qu’il faut attendre de certains pour faire l’Europe, franchement, je crois qu’il vaut mieux cesser cet appareil que faire croire que quelque chose d’important est en train de s’accomplir à ces foules qui, après chaque Session, si elles prennent connaissance de nos travaux, doivent se montrer de plus en plus désillusionnées.
Durant cette quinzaine, nous avons manqué toutes les occasions. D’abord, nous n’avons pas su tirer parti, courageusement, des déclarations si franches et si catégoriques qui nous ont été faites par tous les délégués de la Grande-Bretagne. Bien sûr, il faut encore le leur dire – excusez-moi de le faire – nous étions venus ici avec une certaine espérance. Nous avions pensé que le changement politique, en Angleterre, allait nous donner quelque occasion nouvelle de collaboration plus intime. Nous attendions avec angoisse ce que les représentants du gouvernement conservateur allaient dire et nous attendions aussi avec impatience ce que les travaillistes, rentrés dans l’opposition, allaient nous confier.
Jamais vous n’avez été – et je tiens à vous en rendre hommage – plus catégoriques et plus nets en nous disant, comprenant tout de même ce que c’était pour nous que faire l’Europe: «Jamais avec vous, dans cette voie et sur cette ligne!»
Je le dis, non pas sans un peu de déception, non pas sans un peu d’amertume, mais sans aucun esprit agressif: ces déclarations, que nous attendions, sur lesquelles nous avions misé, pour lesquelles nous manifestions un certain espoir, ne se sont pas produites; nous devions alors avoir courageusement la volonté de prendre acte du fait placé devant nous.
Messieurs, prenez garde. Nous, Européens continentaux, nous avons dit certaines fois: nous ne comprenons pas tout ce que les Anglais nous disent du Commonwealth et de ses obstacles, mais quelquefois – je vais vous parler tout à fait franchement – nous avons le sentiment qu’il y avait quelque prétexte plutôt que quelque raison sérieuse dans ces difficultés que vous nous expliquiez mal et que vous invoquiez sans cesse. Nous avions le sentiment que nous ne pouvions pas avoir votre collaboration à cause du Commonwealth. Faites bien attention! Dans quelque temps, l’opinion publique dira des Européens continentaux qu’ils prennent comme prétexte, pour ne pas faire l’Europe, l’absence et la carence de l’Angleterre. Nous perdrons, vis-à-vis de ceux qui avaient mis tant d’espoir dans l’idée européenne, de ceux dont elle est peut-être à l’heure actuelle le seul espoir, tout notre crédit et toute la confiance qu’ils pouvaient avoir en nous.
Dès le début de cette réunion, ma décision était prise, ma position était claire et posée sans équivoque. Je ne dis pas: faire l’Europe en nous alignant sur l’Angleterre – car en réalité ce n’est pas faire l’Europe que de nous aligner, à l’heure actuelle, sur l’Angleterre conservatrice ou sur l’Angleterre travailliste, c’est y renoncer – mais prendre courageusement position devant le fait et risquer.
Messieurs, je n’oserai pas dire: «Nul plus que moi n’est conscient des dangers qu’il y a actuellement à tâcher de faire l’Europe continentale». Pourquoi «nul plus que moi»? Je pense que tous ceux qui se résignent à faire l’Europe continentale sentent et mesurent les risques d’une telle politique. Mais quelle est la politique un peu grande qui ne comporte pas un risque? Toute la vie est un choix entre des risques différents, et ceux qui n’osent jamais risquer dans leur vie et dans leur politique ne sont pas les grands réalisateurs.
Au lieu de prendre courageusement position devant le nouveau fait anglais, nous avons essayé de trouver des formules d’unanimité qui sont des formules d’impuissance. Dans ces derniers jours, de nouvelles équivoques se sont créées au sujet de problèmes graves qui ont permis encore à certains de croire que le «non» des Britanniques n’était pas absolu et qu’en attendant encore, dans l’inaction et la passivité, il y avait peut-être possibilité de les voir parmi nous.
Puis, hier, nous avons manqué l’occasion de notre vie, l’occasion de notre vie d’Assemblée européenne. Oui, la séance d’hier a été historique, et c’est cela qui me fait de la peine, mais jusqu’au moment où les ministres ont cessé de parler. Quand la parole nous fut rendue’ je n’ai plus rien vu d’historique du tout! (Sourires.)
Nous avons vu des ministres qui se sont présentés devant nous et qui, pour la première fois, venaient non seulement nous expliquer leur politique, mais chercher parmi nous un appui et un encouragement. Oui, c’était historique de voir quatre ministres de quatre pays européens venir nous déclarer: «Nous sommes pour l’Europe unie et nous sommes prêts à essayer de la réaliser parce que nous y sommes poussés par une série de faits, sur lesquels je ne veux pas insister, par une espèce de fatalité et de logique de l’histoire. Nous voulons, à la pointe du combat, tâcher de réaliser une autorité politique dans le domaine de la défense et dans celui des Affaires Étrangères.» Nous sentions bien ce qu’il y avait d’émouvant dans leurs discours. Ils venaient nous dire: «Nous avons des difficultés chez nous, nous devons surmonter des obstacles et briser toutes les anciennes difficultés et les anciennes traditions. Dites quelque chose, vous, les représentants de l’Europe, pour nous aider et pour que nous soyons plus forts.»
Qu’est-ce que nous leur avons répondu? Rien du tout! Nous avons rédigé et voté une motion dont le rapporteur, pour rassurer certains membres de l’Assemblée et obtenir une pauvre majorité, n’a pas même osé dire qu’il s’agissait de faire une vraie autorité politique internationale. Il a laissé planer le doute et, malgré cela, un nombre important de délégués ont dit «non». Ces quatre ministres qui venaient nous demander de les aider, nous les avons renvoyés devant un Comité des Ministres qui doit statuer à l’unanimité et dont nous savons, par conséquent, qu’il ne pourra pas les aider.
Que devions-nous faire? Nous devions, dans ce moment historique, au-delà du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, nous adresser aux quatre ministres, ou aux six pays qui veulent essayer de faire une Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, et leur dire: «Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour vous expliquer maintenant comment nous envisageons cette communauté européenne.»
Nous n’avons pas pu le faire parce que nous savions que, si nous prenions cette attitude, aucune motion n’aurait obtenu les deux tiers des voix. Nous avons, encore une fois, dû nous rallier à ces motions de compromis qui sont, dans l’état actuel des choses, véritablement sans aucun intérêt.
Je me demande si vous mesurez ce qu’il y. a – excusez-moi de vous le dire – d’un peu ridicule à demander au Comité des Ministres où sont représentés douze ministres que nous connaissons et dont nous savons les idées, d’organiser des conférences pour créer des autorités politiques internationales, alors que près de la moitié de ces ministres ont déjà, de la manière la plus formelle, dit qu’ils n’en voulaient pas et que chacun d’entre eux détient, au sein de ce Comité des Ministres, un droit de veto. Si nous ne sommes pas capables de faire plus, alors, véritablement, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre course, et je ne pense pas être trop pessimiste en le disant.
Voyez-vous, j’ai l’impression que nous sommes en train de mourir de notre sagesse. Ce qu’il y a de sagesse dans cette Assemblée! (Sourires.) Ce que les gens sont raisonnables! Ce qu’ils discutent avec soin! Ce qu’ils sont habiles dans toutes les questions de procédure et, comme, sur un mot et sur une virgule, ils peuvent parler avec talent! Messieurs, c’est épouvantable, et votre sagesse est une sagesse meurtrière.
Un jour, j’ai lu dans la Jeanne d’Arc de Bernard Shaw un mot que je n’ai jamais oublié et dont, hélas, je suis forcé de me resservir de temps en temps dans ma vie. Jeanne d’Arc est arrivée devant Charles VII – ici il n’y a pas d’allusion historique. L’Anglais occupe la France. Charles VII est réfugié à Bourges, il est devenu le petit roi de Bourges, personne n’a plus confiance en lui. Jeanne apparaît. Elle n’a rien d’autre que sa foi et son espérance. Elle parle. Tout le monde se moque d’elle – les généraux, les évêques, les juristes – jusqu’au moment où un jeune homme, qui sera son compagnon de combat et, ne l’oublions pas, son compagnon de victoire, dit, alors que l’on répète sans cesse autour d’elle qu’elle n’a pas sa raison, qu’elle est folle: «Laissons faire les fous. Voyez, où les sages nous ont conduits.»
Eh bien, de temps en temps, on a envie dans cette Assemblée d’être un peu fou, de laisser de côté sa sagesse et sa raison, de croire que, pour bâtir les grandes choses dans le monde, un peu d’espérance, un peu de confiance et un peu de foi servent plus que toutes les sagesses procédurières.
Pourquoi est-ce que je vous demande de voter l’amendement de M. Teitgen? Je vous demande de le voter parce qu’il est positif et parce qu’il explique clairement, beaucoup plus clairement que les deux articles du Statut auxquels il s’applique, ce vers quoi un certain nombre d’entre nous veulent aller.
M. Teitgen et M. de Menthon ne seront pas mécontents si je dis que leur idée n’est pas toute neuve, que le premier auteur de cette idée, c’est M. Mackay, dans ce protocole que l’Assemblée a trop souvent traité avec mépris. Hélas, on ne s’est pas aperçu qu’à un moment donné M. Mackay, et aujourd’hui M. Teitgen et M. de Menthon, apportent la solution à une des questions auxquelles nous nous sommes heurtés depuis le début.
Ah! le beau jour plein d’enthousiasme encore et plein d’illusions où, à la quasi-unanimité, l’Assemblée votait cette résolution où l’on réclamait des autorités limitées avec des pouvoirs réels! Or, pendant trois ans, on a tourné autour de la question, cherchant à voir où cela pouvait conduire, ce que cela pouvait signifier, cherchant des formules.
La formule que reprend aujourd’hui M. Teitgen a l’immense avantage de régler la question dans le fait.
Quand nous avons voulu essayer de dire ce que c’était qu’une autorité limitée, nous nous sommes heurtés à une impossibilité, parce qu’il n’y a pas de définition théorique de l’autorité limitée. L’amendement de M. Teitgen a pour effet de créer le pouvoir exécutif de l’Assemblée au fur et à mesure que les questions pratiques posées par les autorités spécialisées ont été réglées. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de faire une définition théorique des pouvoirs limités. Chaque fois qu’une autorité spécialisée a été créée, chaque fois qu’un problème particulier a été résolu, petit à petit et dans le fait naît et se développe le pouvoir exécutif de l’Assemblée.
Ce n’est pas encore tout ce que nous voudrions, mais c’est tout de même déjà quelque chose, quelque chose de positif, et c’est pourquoi je voterai l’amendement de MM. Teitgen et de Menthon. Je le voterai comme je voterai tout ce qui actuellement, sans recherche de vains compromis, montre à ceux qui nous regardent du dehors ou qui rendent compte de nos débats qu’il y a tout de même dans cette Assemblée un certain nombre d’hommes qui prennent le problème de la construction de l’Europe au sérieux et que nous sommes prêts à sacrifier pour l’Europe des choses auxquelles nous tenons autant que n’importe quel autre pays du monde: une partie de notre souveraineté nationale, et même quelquefois – je n’ai jamais hésité à le dire – certains intérêts matériels.
Aujourd’hui, que vous le vouliez ou non, l’intérêt de la cause de l’Europe unie – et c’est ce qui est à la base de ma tristesse – ne se trouve plus dans cette Assemblée. Ceux qui veulent continuer dans la voie où nous nous sommes engagés depuis quelques années savent maintenant qu’ici les possibilités sont devenues quasi nulles, qu’il faut regarder au-delà de ces murs, que c’est de nouveau en faisant appel à la propagande, à l’opinion publique, en l’alertant, en lui montrant la situation réelle, en lui expliquant comment elle doit se sauver si elle veut éviter le désastre, que l’on trouvera la solution du problème.
C’est parce que j’en ai eu le sentiment profond, et, croyez-moi, le sentiment amer, au cours de ces quinze derniers jours, que j’ai voulu reprendre toute ma liberté, reprendre ma place parmi les vrais combattants de l’Europe pour leur dire: hâtons-nous! Nous perdons du terrain. Ce que nous aurions pu faire il y a un an ou deux, nous ne pouvons plus le faire aujourd’hui parce qu’on commence à se moquer de nous, on parle de notre impuissance. Il n’y a plus un moment à perdre si nous voulons nous sauver.
(Applaudissements.)