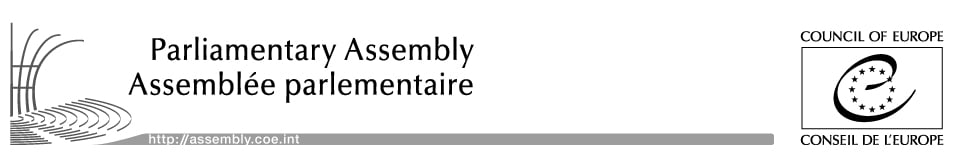Maurice
Couve de Murville
Premier ministre de la République française
Discours prononcé devant l'Assemblée
jeudi, 15 mai 1969

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis reconnaissant à votre Assemblée de m’avoir invité à participer aujourd’hui à la célébration du 20' anniversaire du Conseil de l’Europe. C’est au nom de mon Gouvernement et de mon pays que je vous exprime ces remerciements, car ils sont l’un et l’autre heureux que la France ait été depuis l’origine le siège de vos réunions. Le salut et les vœux que je vous apporte de leur part ont donc un caractère particulièrement amical et chaleureux.
C’est aussi en mon nom personnel que je tiens à vous remercier, d’abord parce que je ressens tout l’honneur de votre invitation, ensuite pour des raisons plus personnelles. Il se trouve en effet qu’il y a presque exactement vingt ans, le 8 août 1949, j’avais assisté à la séance inaugurale de votre Assemblée, en une qualité très modeste, mais dans des conditions dont je n’ai pas perdu le souvenir. Il y avait là nombre de personnalités illustres, dont le nom reste ou restera dans l’histoire: Winston Churchill et Bevin pour la Grande-Bretagne, M. de Valera pour l’Irlande, Sforza et le président Saragat pour l’Italie; pour la France, entre autres, Edouard Herriot, Paul Reynaud, Robert Schuman. Personne, bien sûr, n’imaginait très bien ce que pourraient être l’activité et le rôle de la nouvelle institution. L’éloquence, qui, alors, existait encore, se donnait libre cours, dans la sincérité et dans l’émotion. Surtout apparaissait de toutes parts la bonne volonté la plus ouverte face à une initiative issue d’un grand élan. Cet élan ne s’appelait pas encore la construction européenne, mais on pressentait que, dans un continent ruiné, tourmenté, anxieux de son avenir, il correspondait à un irrésistible besoin et devrait déboucher, sans que personne fût en état d’en préciser les formes ou les modalités, sur l’entente et la coopération, pour le progrès et pour la paix.
Je dis pour la paix, car si tout apparaissait incertain, y compris la définition même de l’Europe, chacun s’accordait à dire que le premier objectif était de mettre un terme définitif aux guerres fratricides qui avaient jalonné notre histoire et fait périodiquement le malheur de nos peuples. Chacun s’accordait aussi pour affirmer que la condition nécessaire en était la réconciliation définitive de la France et de l’Allemagne toujours protagonistes de ces funestes combats.
N’était-ce pas la raison pour laquelle Ernest Bevin avait proposé et fait accepter que le siège du Conseil de l’Europe, même si alors celui-ci ne comprenait pas encore l’Allemagne nouvelle, fût établi à Strasbourg, comme gage de cette réconciliation?
Ce grand dessein n’avait-il pas été aussi le thème essentiel du discours magnifique et fameux que Winston Churchill avait prononcé à Zurich le 16 septembre 1946? Après avoir lancé l’idée des États-Unis d’Europe, le grand homme d’État ajoutait que le premier pas devait être une coopération entre la France et l’Allemagne, que ces deux pays ensemble devaient prendre la direction de la nouvelle union, qu’enfin la Grande- Bretagne et son Commonwealth, la puissante Amérique et, il l’espérait, l’Union Soviétique – car alors «tout serait bien», je cite – devraient être les amis et les répondants de cette nouvelle Europe et se faire les champions de son droit à l’existence.
Vingt années ont passé depuis les moments historiques que j’évoquais à l’instant, vingt années au cours desquelles le monde entier a vécu des transformations radicales, à commencer par l’immense œuvre de la décolonisation, vingt années au cours desquelles l’Europe, pour sa part, a pris un visage totalement nouveau. Me permettrez-vous de dire, Mesdames, Messieurs, en toute humilité, qu’il m’est donné peut-être d’en parler un peu en connaissance de cause, car sur ces vingt ans, pour ce qui concerne la France, onze ont été marqués par les gouvernements auxquels j’ai eu l’honneur d’appartenir, notamment en qualité de ministre des Affaires Etrangères; et je ne pense pas, quoi que l’on puisse entendre parfois, ici ou là, que tout ce qui s’est fait en matière de politique européenne l’ait été pendant les neuf années précédentes.
Si l’on cherche à dresser un bilan, la célébration de ce jour impose bien entendu de commencer par vous-mêmes, c’est-à-dire par l’Assemblée Consultative et le Conseil de l’Europe. Vous ne prétendez certes à rien de spectaculaire, mais l’on aurait tort de dire que votre rôle, au cours de cette longue période, n’a pas été utile et constructif.
Vous avez réuni progressivement, et maintenant le terme est atteint, toutes les nations de l’Europe que nous appelons libres. Vous avez réussi à créer entre elles toutes, par vos réunions périodiques, un sentiment de solidarité, d’appartenance au même monde, de communauté effective d’intérêts et de pensée. Comment ne pas croire qu’il y a là quelque chose d’important et même d’essentiel?
Vous avez pris l’habitude de discuter de nos problèmes communs, de nos politiques respectives, voire des difficultés qui peuvent s’élever entre les uns et les autres. Cela aussi est quelque chose de nouveau pour l’Europe. Le souhait que je pourrais exprimer est que vous le fassiez davantage et toujours plus en profondeur, n’hésitant pas à traiter avec audace les grands problèmes qui sont ceux de chacun d’entre nous, quelles que soient sa dimension et sa position géographique, par exemple les rapports avec l’Europe orientale, les rapports avec les États-Unis d’Amérique ou l’immense question des pays sous-développés et de nos devoirs à leur égard.
A cette action politique, vous avez su, avec bon sens, ajouter une forme d’action, que je pourrais appeler la coopération. Votre Assemblée en a été souvent le moteur et l’inspirateur. Cette coopération vise essentiellement à conclure entre nous tous des accords pratiques dans les domaines les plus variés.
Je cite, sans les énumérer tous, les questions juridiques et l’harmonisation des législations, les problèmes sociaux, les problèmes de la jeunesse, la santé publique, l’éducation et la culture, la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles, l’aménagement du territoire, les questions propres aux administrations locales et régionales. Sous le titre général «l’homme dans le milieu européen», toutes ces activités font, depuis quelques années, l’objet d’un programme de travail qui est ambitieux, mais dont l’exécution se déroule dans les meilleures conditions.
Votre Assemblée a eu le mérite de faire en sorte que toujours priorité fût donnée dans ce programme aux actions ayant pour objet l’épanouissement de l’homme. En cela, elle a d’ailleurs rencontré les préoccupations de notre Secrétaire Général qui a pris une part si importante aux travaux du Conseil. Au moment où M. Smithers approche du terme de son mandat, ce m’est une heureuse occasion de lui renouveler l’expression de notre satisfaction et de nos remerciements. Je tiens aussi à féliciter de sa brillante élection et à saluer votre nouveau Secrétaire Général, mon ami M. Toncic, auquel vont tous mes vœux de succès dans sa difficile mission.
Je parlais de votre coopération au sein du Conseil de l’Europe. J’ajoute à ce sujet que cette coopération a commencé à susciter quelque intérêt dans les pays de l’Est, et c’est là un résultat politique notable à mettre à l’actif de cette organisation.
J’ai dit: des pays de l’Est. Dans le bilan des véritables révolutions intervenues depuis vingt ans, comment ne pas souligner de façon particulière les transformations intervenues dans nos rapports avec cette autre partie de l’Europe?
1949: c’était au lendemain du coup de Prague, l’année de la signature du Pacte atlantique. L’Europe occidentale, encore en pleine reconstruction, vivait dans l’obsession d’une nouvelle guerre et ne trouvait de réconfort que dans l’assurance, non seulement de la protection, mais aussi d’une puissante présence chez elle de la force américaine.
1969: rien n’est réglé, à coup sûr, à commencer par le problème allemand, mais la guerre froide est un souvenir qui s’estompe, même si la Tchécoslovaquie, ce coin enfoncé entre les deux parties de l’Allemagne, est toujours l’objet de nos indignations et de notre sympathie.
Ce changement est le fruit d’une lente évolution, devenue irrésistible dès le moment où il est apparu à tous les responsables qu’une guerre – nécessairement nucléaire – serait une folie et qu’en définitive, de part ni d’autre, elle n’entrait dans les pensées. A cette évolution, la France éprouve de la satisfaction à avoir, dès que cela est apparu possible, contribué dans la mesure de ses moyens. Voilà bien des années qu’elle a commencé à chercher, puis à pratiquer la détente. Voilà bien des années qu’entre elle- même et ces pays de l’Est, dont beaucoup sont ses amis de longue date, elle a jeté les fondements d’une coopération dans tous les domaines de l’activité, coopération qui se développe et commence à porter ses fruits. Le général de Gaulle, de sa clairvoyance et de son autorité, a marqué une telle politique, persuadé que la division de l’Europe est un malheur pour tous les Européens, que notre continent ne retrouvera la véritable paix, y compris un règlement allemand, qu’une fois des relations normales, et si possible amicales, établies d’un bout à l’autre, dans les limites que trace la géographie. Cette politique, qui paraissait hétérodoxe, oh combien!, a soulevé à ses débuts bien des critiques et des appréhensions, heurté bien des routines. Qui s’en souvient aujourd’hui, alors qu’elle est devenue la politique de tous, alors qu’il apparaît de plus en plus qu’États-Unis et Union Soviétique en arrivent à ce dialogue direct dont ils rêvent depuis vingt-cinq ans, et que nous ne pouvons pour notre part qu’approuver dès lors qu’il ne s’agirait pas de régler, entre ces deux grandes puissances, les problèmes qui sont ceux des autres, et d’abord les problèmes de l’Europe?
Dans ce continent en pleine mutation, certaines nécessités permanentes apparaissent cependant. La première est celle de l’équilibre, qui, depuis qu’il y a des hommes, des nations et des États, est la condition de tout et d’abord de la paix. Face à une Europe orientale qui demeure monolithique dans son régime et dans ses alliances, l’Europe occidentale doit trouver les moyens de s’affirmer et d’exister par elle-même. Je dis par elle-même, car autrement rien de durable ne peut être imaginé, même si, pour nous aussi, les alliances – et chacun voit bien ce que je veux dire – demeurent et demeureront sans doute longtemps encore nécessaires, précisément pour des raisons d’équilibre que je disais. Voilà la vraie justification de ce qu’il est convenu d’appeler entre nous la construction européenne.
Il n’en allait certes pas ainsi en 1949. Peut-être nos anciens pensent-ils encore à notre grande entreprise dans les termes de cette époque, j’entends par là un rassemblement purement défensif de tout ce qui se trouve à l’ouest d’un rideau de fer qui coupe l'Europe en deux, et l’Allemagne avec elle, et qu’une guerre froide indéfinie ne permettrait jamais de lever.
Les perspectives de 1969 ne sont plus les mêmes. C’est à leur lumière que la France, pour sa part, conçoit cette construction européenne.
Rien naturellement ne pouvait être tenté si, d’abord, les conditions d’une paix définitive n’étaient pas réalisées à l’intérieur même de cette Europe occidentale, en d’autres termes s’il n’était pas mis un point final à l’éternel antagonisme entre la France et l’Allemagne. Nous avons suivi les conseils qui nous avaient été, dès la fin de la guerre, généreusement, et à juste titre, prodigués de toutes parts. C’est à Robert Schuman qu’il appartint, dès 1949 et 1950, de jeter les fondements de cette nouvelle politique; son mérite ne fut pas mince. C’est au général de Gaulle, de concert avec ce grand homme d’État que fut le chancelier Adenauer, qu’il revint — et lui seul en France pouvait en prendre la responsabilité — de sceller définitivement cette réconciliation historique par le traité du 21 janvier 1963, étape décisive pour l’Europe d’après- guerre, et, je le crois, pour l’Europe de l’avenir.
Condition nécessaire de la construction européenne, la coopération franco-allemande ne peut être considérée comme une condition suffisante. C’est ce que, je crois, notre collègue M. Willy Brandt disait il y a quelques jours à cette même tribune. Ce sont toutes les nations de l’Europe occidentale qu’il s’agit d’associer, et d’abord celles que la géographie, l’histoire ou les affinités naturelles conduisent le plus naturellement à s’entendre et à coopérer.
Il n’est pas d’autre explication à la création de la Communauté Economique Européenne, qui fut dès l’origine et demeure la base de l’organisation économique de l’Europe occidentale; un jour, je l’espère, aussi de son organisation politique, comme la France l’avait, dès 1962, proposé à ses partenaires.
Depuis le 1er janvier 1959, le Marché commun est en route. Qui pourrait contester qu’il soit devenu une réalité internationale de première grandeur? L’union douanière est réalisée depuis le 1er juillet dernier, en avance de dix-huit mois sur l’échéance prévue. La politique agricole, pierre angulaire de l’édifice et constant souci des gouvernements est largement en place, même si nombre de ses dispositions restent à régler définitivement et même si l’expérience doit conduire à des aménagements ou à des révisions. L’union économique, à peine entamée, elle, ne dépend, pour progresser sans à-coups, que de la volonté d’action des partenaires. Dans le domaine international enfin, la Communauté a marqué son existence et son unité dans la grande négociation tarifaire, dite du Kennedy round, et n’a pas peu contribué au succès de cet effort sans précédent de libération du commerce international.
La France qui, lors de l’élaboration du Traité de Rome, paraissait hésitante et multipliait les clauses de sauvegarde, a participé pleinement et de tout cœur à cette mise en œuvre: elle a, je crois pouvoir le dire par expérience, contribué d’une façon décisive aux progrès réalisés.
Tout cela n’est pas allé, certes, sans vives discussions, sans difficultés et sans crises. Qui pourrait s’en étonner, dès lors qu’il s’agissait de passer des déclarations éloquentes et des professions de foi sans lendemain aux dures réalités de la vie économique? N’est-ce pas la meilleure preuve que l’on faisait quelque chose? Arrivée au fait et au prendre, les partenaires voyaient s’opposer les intérêts que le devoir de chacun d’eux était de défendre et que l’on n’arrivait pas toujours sans peine à concilier. Mais ce n’est pas cela qui compte. Ce qui importe, en définitive, c’est que l’accord s’établisse. Dans l’histoire déjà longue du Marché commun, je ne connais pas de cas où nous ne soyons pas parvenus à trouver les compromis nécessaires.
Est-il d’ailleurs, Mesdames, Messieurs, preuve plus décisive du succès de l’entreprise que le rayonnement qu’elle a acquis, que l’attraction qu’elle exerce, que le fait, pour tout dire, que le sujet du jour reste, depuis des années maintenant, le problème de l’élargissement?
Sur ce sujet, les passions sont devenues trop vives et certaines positions trop unilatérales pour qu’il me paraisse opportun d’en traiter au fond dans une cérémonie d’anniversaire telle que celle-ci, qui doit être l’occasion de rechercher ce qui unit plutôt que ce qui sépare.
La France, pour sa part, a depuis longtemps, bien longtemps, expliqué sa position, faite de deux considérations à son avis complémentaires. L’une est que de nouvelles adhésions sont en effet légitimes et qu’à coup sûr la Communauté Economique Européenne ne restera pas toujours ce qu’elle est aujourd’hui. L’autre est que, si ce premier principe est accepté, il faut étudier les conditions, les conséquences et les étapes éventuelles des décisions à prendre. Autant que possible, il ne faut pas porter atteinte à ce qui existe, mais il ne faut pas non plus se dissimuler les conséquences inévitables de ses actes. C’est, chacun le sait, sur la deuxième de ces considérations qu’à ce jour, à notre regret, l’accord n’a pu se faire.
Le débat, bien entendu, reste ouvert, et nous savons qu’il se poursuit à toute heure, et en tous lieux. Beaucoup pensent qu’il ne manquera pas prochainement de renaître. De toutes façons, ce qui est inévitable lorsque sonne l’heure des décisions, c’est-à-dire l’heure de la vérité, c’est que chacun prenne ses responsabilités et accepte de mettre en accord ses résolutions avec ses pensées et ses arrière-pensées.
On dit beaucoup de nos jours que l’Europe traverse des temps difficiles. Me permettra-t-on de suggérer, comme je le faisais tout à l’heure à l’occasion du Marché commun, qu’il en va toujours ainsi lorsque l’on passe des généralités faciles et flatteuses aux dures réalités de la vie et de l’action. Mais pourquoi manifester à tout propos tant de pessimisme? Comment, au contraire, ne pas être rempli d’espoir lorsque, comme le Conseil de l’Europe en offre aujourd’hui la précieuse occasion, on mesure le chemin parcouru depuis l’origine et par conséquent les progrès accomplis? Comment peut-on ne pas être frappé du contraste extraordinaire qui existe entre les velléités et les balbutiements d'il y a vingt ans et les réalisations d’aujourd’hui, étonnantes même si elles sont partielles, et par conséquent lourdes de lendemains constructifs?
Cela est vrai à l’évidence pour ce qui est de l’économie. Non seulement les Six du Marché commun, mais l’Europe occidentale tout entière, constituent d’ores et déjà, même si ce n’est que virtuellement, un ensemble dont nous savons qu’il ne pourra qu’aller se fortifiant et se précisant pour la prospérité et le progrès de tous.
Cela commence même à poindre pour ce qui est de la politique. Depuis l’origine, nous autres, Français, avions l’espoir que peu à peu pourrait se dégager entre nous tous une volonté commune, pour ne pas dire une politique, qui, parmi les géants de ce monde, permettrait à nos vieilles nations de reprendre un rôle, de retrouver une influence, que les folies du passé semblaient il y a un quart de siècle avoir fait entrer pour toujours dans l’histoire. Nous parlions dans cet esprit d’une Europe européenne. Le but est encore lointain, mais cette expression qui naguère faisait sourire, sinon, scandalisait, est peu à peu entrée dans la conscience générale. Nombreux sont aujourd’hui ceux qui l’utilisent à leur tour, y compris ceux de nos amis auxquels cependant les vicissitudes présentes paraissent nous opposer.
Quel plus éclatant témoignage de cette bénéfique évolution que les propos tenus à son retour à Washington par le Président des États-Unis après son récent voyage en Europe, lorsqu’il disait par exemple, et je cite:
«Le général de Gaule croit que l’Europe est fondée à avoir une position indépendante. Et, franchement, je le crois aussi.»
Mesdames, Messieurs, je ne pense pas pouvoir trouver de meilleure conclusion aux remarques que votre aimable invitation dont, encore une fois, je vous remercie, m’a permis de présenter à votre Assemblée. C’est une conclusion d’espoir qui, si l’on veut se dégager des polémiques, des disputes, des vicissitudes de la vie quotidienne, me paraît justifiée par ce qu’ensemble nous avons déjà accompli, par la volonté profonde de nos nations de s’affirmer et de travailler ensemble, enfin par l’immense besoin qui apparaît partout, et d’abord chez nous-mêmes, d’une Europe qui continue à apporter au monde l’irremplaçable concours de ses capacités et de sa civilisation. Puissent, dans vingt années d’ici, nos successeurs être en mesure de faire à leur tour un bilan qui réponde à toutes les espérances d’aujourd’hui.