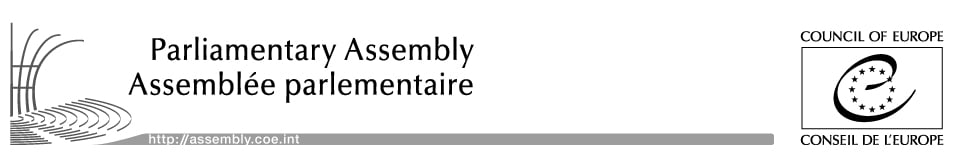1. Procédure
suivie à ce jour
1. La proposition de résolution intitulée «La souveraineté
nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain:
nécessité d’une clarification» a été renvoyée le 21 juin 2010 à
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
pour rapport

. Lors de sa réunion
du 5 octobre 2010, la commission a nommé M. Holger Haibach (Allemagne,
PPE/DC) en tant que rapporteur.
2. Lors de sa réunion du 16 décembre 2010, la commission a tenu
une audition avec les experts suivants

:
- professeur
Helen Keller (université de Zurich, Suisse);
- professeur Vladimir Kotlyar (université d’Etat des relations
internationales, Moscou, Fédération de Russie);
- professeur Alain Pellet (université de Paris Ouest Nanterre,
France);
- professeur Matthias Herdegen (université de Bonn, Allemagne).
3. Lors de sa réunion du 26 janvier 2011, la commission a nommé
Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE)
en tant que nouveau rapporteur.
2. But du présent
rapport
4. Comme cela est souligné dans la proposition de résolution,
les concepts de souveraineté nationale et de statut d’Etat ont considérablement
évolué ces dernières années. L’évolution des pratiques étatiques concrètes
– y compris dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et dans
les relations entre ces Etats – montre que dans le cadre du droit
international contemporain, la question des critères constitutifs
d’un Etat reste polémique. Il y a un véritable flou quant au caractère
légal de certaines évolutions récentes – notamment l’émergence de
nouvelles entités qui souhaitent être reconnues en tant qu’Etat
à part entière.
5. L’un des exemples les plus récents, à cet égard, est la sécession,
par rapport à la Géorgie, des territoires d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie
(Géorgie) – décrétée de manière unilatérale, avec la protection
de l’armée russe. La Fédération de Russie elle-même, née de l’effondrement
plutôt pacifique de l’ex-Union soviétique, est encore menacée par
des mouvements irrédentistes de la région du Caucase du Nord. En
Moldova, la région de Transnistrie n’est plus sous le contrôle du
pouvoir central depuis de nombreuses années. L’Espagne est confrontée
à un mouvement séparatiste au pays basque, et la Turquie doit faire
également face à un mouvement nationaliste kurde puissant. L’ex-République
fédérale socialiste de Yougoslavie a éclaté à la suite d'une guerre
violente. L’un des épisodes les plus récents est la déclaration
unilatérale d’indépendance du Kosovo

par rapport
à la Serbie. En revanche, il faut noter que la République tchèque
et la République slovaque ont réussi à «divorcer» de manière pacifique.
La Belgique est déchirée par des bouleversements politiques constants
et l’on est toujours à la recherche d’un compromis entre Flamands
et Wallons. L’indépendance de Chypre, liée à un accord de garantie
trilatéral aujourd’hui obsolète, a été le dernier acte du processus
de décolonisation européen. Chypre est divisée de fait depuis plusieurs
décennies, en dépit de la quasi-unanimité de la communauté internationale
pour ne pas reconnaître l’entité sécessionniste du nord de l’île,
proclamée sous la protection de l’armée turque.
6. Tous ces exemples montrent, semble-t-il, que l’absence de
définition claire des critères constitutifs du statut d’Etat et
du concept de souveraineté nationale menace gravement la paix et
la stabilité, même sur le continent européen. L’objectif très modeste
du présent rapport est de rappeler quelques principes fondamentaux
du droit international dans ce domaine et de mobiliser les efforts
dans le sens d’un débat approfondi, au niveau des Nations Unies,
sous forme d’une conférence de suivi des travaux de la Commission internationale
de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE) – commission
dont les conclusions ont été publiées en 2001. En m’inspirant des
résultats de l’audition menée avec des experts du droit international en
décembre 2010, je rappellerai tout d’abord très brièvement les grands
principes généralement reconnus en matière de critères du statut
d’Etat et de la souveraineté nationale, ainsi que les conclusions
de la CIISE. Je tenterai ensuite de formuler quelques conclusions
sur les problèmes pratiques soulevés dans la proposition de résolution,
en soulignant les points qui doivent être clarifiés.
3. Principes fondamentaux
en ce qui concerne le statut d’Etat et la souveraineté nationale
3.1. Critères du statut
d’Etat
7. Comme l’a souligné le professeur Keller lors de l’audition,
la définition du «statut d’Etat» formulée par Georg Jellinek en
1900

reste
communément admise: pour parler d’Etat, il faut un peuple, un territoire
et une autorité nationale. L’existence de ces trois éléments est
considérée comme une question purement factuelle.
8. En droit public international, la doctrine prévalente est
que la reconnaissance d’un nouvel Etat par d'autres Etats a un caractère
purement déclaratif. En fait, un Etat existe ou non, indépendamment
de la reconnaissance des autres. La raison de la prévalence de cette
doctrine est qu’aucun Etat ne peut s’autoriser à décider du statut
d’un autre Etat, car cela serait en contradiction avec le principe
d'égale souveraineté de tous les Etats.
9. Cela dit, la reconnaissance d’un Etat par de nombreux autres
Etats – ou l’absence de reconnaissance – est un élément concret,
qui a un poids considérable dans le fait de déterminer si les éléments
nécessaires au «statut d’Etat» sont présents ou non

.
Dans son exposé devant la commission, le professeur Herdegen a souligné
que, pour évaluer le caractère «effectif» d’une autorité étatique,
il convenait de procéder à une analyse complexe de l’ensemble des
facteurs pertinents, y compris la capacité éventuelle du nouvel
«Etat» à prévaloir, à long terme, sur l’autorité concurrente de
l’Etat prédécesseur. Le résultat d'une telle analyse peut fort bien
être influencé par l’attitude d’autres Etats et d'organisations
internationales vis-à-vis de l’Etat nouvellement proclamé – notamment
le fait que les autres Etats soient prêts ou non à coopérer avec
le nouvel Etat et à le soutenir.
10. Le professeur Herdegen a également souligné qu’en droit international
il n’y avait pas d’obligation de reconnaissance des nouveaux Etats.
Cela permet aux autres Etats et aux organisations internationales
de conditionner la reconnaissance du nouvel Etat ou son adhésion
à telle ou telle organisation au respect de certains critères substantiels.
Personnellement, je suis d’accord avec le professeur Herdegen pour
dire que le Conseil de l’Europe devrait établir certaines normes
fondamentales dont le respect soit une condition préalable à la
reconnaissance d’un nouvel Etat membre et à son adhésion. En fait,
dans ses avis plus récents sur l’adhésion de nouveaux Etats membres
au Conseil de l’Europe, l’Assemblée a montré la voie: l’adhésion
ne peut se faire qu’à la condition de respecter un certain nombre
d’engagements – processus contrôlé par la commission de suivi de
l’Assemblée. Les critères de l’Assemblée sont très proches de ceux
définis dans les «Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux
Etats en Europe orientale et en Union soviétique»

, adoptées par les
ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Union européenne:
- le respect de la démocratie,
de l’Etat de droit et des droits de l’homme;
- des garanties pour les groupes ethniques et les minorités;
- la reconnaissance de l’inviolabilité des frontières existantes;
- la reconnaissance des engagements existants en matière
de désarmement et de non-prolifération nucléaire;
- l’obligation de régler les conflits de manière pacifique.
11. Lors des débats dans le cadre de l’audition, on s’est demandé
si l’on pouvait «annuler» la reconnaissance d’un Etat si celui-ci
ne remplissait plus les conditions ayant permis sa reconnaissance.
En fait, nos experts ont considéré que la reconnaissance d’un Etat
ne pouvait pas être ainsi annulée; mais ils ont précisé que les
organisations internationales pouvaient réagir à certaines violations
des obligations liées à l’appartenance d’un Etat à telle ou telle
organisation, en lui retirant certains droits – voire l’intégralité
des droits – octroyés lors de l’adhésion. Nous devons savoir que
cette possibilité existe et ne pas hésiter à y recourir dans les
cas appropriés.
3.2. Evolution du concept
de souveraineté nationale
12. Dès lors qu’il existe, un Etat est «souverain», sur
le plan intérieur comme extérieur, et a le droit de choisir librement
son système politique, social, économique et culturel, et de le
développer

.
13. La définition traditionnelle de la «souveraineté» des Etats
se réfère à leur compétence, à leur indépendance et à l’égalité
en droit de tous les Etats. Ce concept recouvre généralement tous
les domaines dans lesquels un Etat est autorisé, en vertu du droit
international, à décider et à agir sans aucune ingérence d’autres
Etats souverains

.
Cette définition de nature positive – selon laquelle les obligations
juridiques internationales sont exclusivement liées au consentement
des Etats souverains – sous-tend encore le célèbre arrêt de la Cour
permanente de justice internationale, en 1927, dans l’affaire du
Lotus

.
14. Cependant, comme le déclarait M. Boutros Boutros-Ghali, ancien
Secrétaire général des Nations Unies, «[l]e temps de la souveraineté
absolue (…) est passé; sa théorie n’a jamais coïncidé avec la réalité»

. Le professeur Keller a très justement résumé
l’acception moderne du concept de souveraineté nationale, en parlant
de «souveraineté en vertu du droit» – en d’autres termes, une souveraineté
inscrite dans le droit et limitée par celui-ci.
15. Depuis la reconnaissance et le renforcement des droits de
l’homme et de leur protection à l’échelle internationale, on s’interroge
de plus en plus: cette question du respect des droits de l’homme
doit-elle rester le domaine réservé des Etats souverains? M. Kofi
Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies, a prôné, dans
un entretien accordé à l’hebdomadaire
The
Economist qui est resté dans les mémoires, une conception
de la souveraineté nationale davantage axée sur les droits de l’homme:
«Aujourd’hui, d’une manière générale, on considère que les Etats
sont au service de leur peuple, plutôt que l’inverse. Parallèlement,
la "souveraineté individuelle" – c’est-à-dire, à mes yeux, la liberté
fondamentale de chaque individu – (…) s’est renforcée du fait d’une
prise de conscience nouvelle et croissante des droits individuels.
A la lecture de la Charte des Nations Unies, aujourd’hui, nous considérons
plus que jamais que son objectif est de protéger l’être humain,
et non pas ceux qui l’exploitent»
![(12)
Kofi Annan: «Two Concepts
of Sovereignty» [Deux conceptions de la souveraineté], The Economist, 18 septembre 1999, <a href='http://www.un.org/News'>www.un.org/News</a>.](/nw/images/icon_footnoteCall.png)
.
16. En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, dont tous les Etats
membres sont parties à la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5), les choses sont claires:
toute violation des droits de l’homme garantis par la Convention
ne peut être considérée comme une «affaire intérieure» des Etats
concernés. Ces violations sont examinées par la Cour européenne
des droits de l’homme, dont les arrêts sont mis en œuvre sous l’égide
du Comité des Ministres. De toute évidence, un tel processus équivaut,
pour les Etats, à un renoncement volontaire à leurs «droits souverains».
17. Ce processus d’abandon volontaire de certains aspects de la
souveraineté nationale progresse – notamment dans le contexte de
l’intégration européenne. L’une des conséquences de la mondialisation
au niveau économique est que chaque pays européen aurait du mal
à affirmer, de manière isolée, son «indépendance» dans un domaine
tel que le commerce international. Des pays européens ont renoncé
en partie à leur souveraineté dans des domaines tels que le commerce,
les tarifs douaniers, les règles de la concurrence et autres secteurs
connexes, et autorisé l’Union européenne à agir en leur nom dans
ces domaines. Plus récemment encore, les Etats membres ou non de
la zone euro qui ont laissé les déficits publics augmenter pendant
trop longtemps ont pris conscience du fait qu’ils n’étaient plus
libres de fixer librement leurs dépenses sociales et autres, ni
leur politique budgétaire. Sur les marchés financiers internationaux,
les primes de risque de plus en plus importantes ont effectivement
réduit la souveraineté nationale – et ce processus résulte en partie
d’un choix volontaire des Etats, dans la mesure où certains pays
ont opté pour un endettement qui ne peut pas être durable à long
terme.
18. Un autre aspect du problème – dans le sens de la réduction
de la souveraineté nationale – est celui de la légalité d’une intervention
visant, contre son gré, un Etat coupable de graves violations des
droits de l’homme. Cette question de l’émergence d’une «responsabilité
de protéger» est au cœur du rapport de la CIISE. Comme nous le savons,
c’est cet argument qui a été invoqué – à tort ou à raison – pour
justifier les interventions de la Turquie à Chypre, de l’OTAN en
République fédérale de Yougoslavie, ou encore de la Fédération de
Russie en Géorgie. Le danger existe que cette «responsabilité de
protéger» peut être invoquée abusivement afin de justifier le recours
à la force dans des cas où, en réalité, il ne s’agit nullement de
prévenir des violations graves et massives des droits de l’homme
ou d’y mettre un terme. Par conséquent, il convient d’abord de définir
de manière très stricte le champ et les conditions d’une intervention
humanitaire. D’autre part, à la lumière du massacre de Srebrenica
et du génocide au Rwanda, on doit également défendre de manière
très ferme le principe d’un droit, voire d’un devoir, d’intervention
afin de prévenir des violations en masse des droits de l’homme ou
d’y mettre un terme. Toutefois, la définition précise des fondements
juridiques et de la portée d’un tel droit dépasse très largement
le cadre du présent rapport.
4. Résumé des conclusions
de la CIISE
19. En 1999, dans le cadre de l’Assemblée générale des
Nations Unies, M. Kofi Annan, alors Secrétaire général, a appelé
la communauté internationale à l’«unité» autour du principe d’intervention
humanitaire: «Si l’intervention humanitaire est considérée comme
une atteinte inacceptable à la souveraineté nationale, comment réagir,
dès lors, à des événements tels que ceux du Rwanda ou de Srebrenica,
autrement dit à des violations flagrantes, massives et systématiques
des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de toutes nos valeurs
communes, sur le plan humain?»

C’est en
réponse à ce défi que, en septembre 2000, dans le cadre de l’Assemblée
générale des Nations Unies, a été créée la CIISE, à l’initiative
du Canada et d’un groupe de fondations importantes. Le thème central
du rapport de la CIISE est résumé par l’intitulé du document («La responsabilité
de protéger»): l’idée est que tout Etat souverain a le devoir de
protéger ses citoyens d’événements tragiques évitables, tels que
les massacres, les viols ou encore la famine, et que, si tel ou
tel Etat n’a pas la volonté ou la capacité de le faire, ce devoir
de protection doit être pris en charge par la communauté internationale.
20. Les conclusions de la CIISE figurent dans un résumé annexé
au présent rapport; il convient de noter un fait assez remarquable:
ces conclusions ont été adoptées par un consensus des 12 commissaires
composant la CIISE et représentant – aussi bien sur le plan géographique
que politique – un éventail important d’experts, universitaires
et techniques, du droit international et des relations internationales

.
21. La principale conclusion de la CIISE est que la souveraineté
nationale implique la responsabilité. Si un Etat n’a pas la volonté
ou la capacité de prévenir des problèmes préjudiciables à son peuple
ou d’y mettre un terme, le principe de non-intervention doit céder
le pas à celui du devoir de protection qui incombe à la communauté
internationale. Dans le cadre de ce devoir de protection, la commission
regroupe trois volets: la responsabilité de prévenir, la responsabilité
de réagir et la responsabilité de reconstruire. A cet égard, priorité est
donnée à la prévention.
22. La responsabilité de prévenir ou celle de réagir doit toujours
impliquer les mesures les moins gênantes et les moins coercitives
possibles. L’intervention militaire à but humanitaire doit rester
une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Pour décider une telle
intervention, il faut qu’il y ait eu «une atteinte grave et irréparable»
à la vie d’êtres humains; ou bien ces atteintes doivent être considérées
comme imminentes, sur le point de provoquer des pertes de vie massives
ou un nettoyage ethnique à grande échelle. La commission définit
également des «principes opérationnels» pour tout type d’intervention
– notamment des objectifs précis, un mandat clair et sans ambiguïté
pour toute la période concernée, et des ressources appropriées.
23. L’un des points importants, sur lesquels la commission insiste
tout particulièrement, est celui de la responsabilité première du
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui doit
accorder son autorisation avant toute intervention militaire. La
commission demande également aux membres permanents du Conseil de
sécurité de ne pas opposer leur veto à l’adoption de résolutions
qui autorisent une intervention militaire à des fins humanitaires,
si les résolutions en question sont très majoritairement soutenues. Cependant,
la commission aborde aussi les cas où le Conseil de sécurité rejette
une proposition ou ne l’examine pas dans des délais raisonnables,
et ouvre ainsi la voie à des organisations régionales ou sous-régionales
qui, aux termes du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
peuvent agir sous réserve d’une autorisation ultérieure du Conseil
de sécurité. Enfin, la commission invite le Conseil de sécurité
à prendre en considération, dans l’ensemble de ses délibérations,
le fait que, s’il ne s’acquitte pas de sa «responsabilité de protéger»
face à des situations choquantes et exigeant une intervention, les
Etats concernés pourront envisager d’autres moyens de répondre à
la gravité et à l’urgence des situations en question, et que, dès
lors, la stature et la crédibilité des Nations Unies pourront en
souffrir. En d’autres termes, la commission laisse la porte ouverte
à des interventions d’urgence sans l’approbation du Conseil de sécurité
– même si cela n’est envisagé que face à des «situations qui choquent
les consciences et appellent une intervention d’urgence».
24. Les conclusions de la CIISE ont donné lieu à des débats lors
des 59e et 60e sessions
de l’Assemblée générale des Nations Unies. A sa 60e session,
l’Assemblée générale a adopté une résolution

confirmant le principe de «responsabilité
de protéger» de tout Etat et de la communauté internationale dans
son ensemble. Elle définit quatre situations susceptibles d’engager
la responsabilité de la communauté internationale: les génocides,
les crimes de guerre, les «nettoyages ethniques» et les crimes contre
l’humanité. Cependant – comme le souligne le professeur Kenig-Witkowska
dans son document –, la résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies diffère en plusieurs points des propositions du rapport de
la CIISE. En particulier, la résolution ne répond pas à la question
des décisions à prendre en l’absence de position commune du Conseil
de sécurité des Nations Unies; en outre, la résolution rejette le
droit à une intervention humanitaire unilatérale. Par conséquent,
on peut affirmer clairement que ce travail est en partie «inachevé»
et devra faire l’objet d’une nouvelle conférence, susceptible de
prendre en considération les propositions avancées en 2001 par la
CIISE.
5. Problèmes concrets
en matière d’évolution des critères constitutifs du statut d’Etat
et de la souveraineté nationale
5.1. Le droit à la sécession?
25. La question de savoir s’il existe un droit (unilatéral)
de sécession n’est pas nouvelle – et la réponse classique a toujours
été qu’un tel droit n’existait pas, en principe, du fait de la prévalence
de l’intégrité territoriale des Etats. Cependant, dans la pratique,
les déclarations unilatérales d’indépendance ont été jugées légitimes
dans le cadre du processus de décolonisation, par lequel des peuples
soumis à la domination et à l’exploitation étrangères ont pu déclarer
leur indépendance par rapport au pouvoir colonial, en appliquant
leur droit à l’autodétermination

.
26. Toutefois, en dehors d’un contexte de décolonisation, l’opinion
générale est que le droit à l’autodétermination ne peut pas autoriser
toute minorité régionale à faire sécession par rapport à un Etat existant

. L'autodétermination de groupes
minoritaires doit plutôt s’inscrire dans une participation au gouvernement
d'Etat, et sous forme de délégation de pouvoir dans un processus
d’autonomie régionale – autonomie qui doit recouvrir les secteurs
de l’éducation et de la culture, entre autres, mais qui ne doit
pas conduire à l’indépendance.
27. Dans le contexte de la reconnaissance du principe de «responsabilité
de protéger» (voir
supra),
on peut se demander si une minorité régionale peut avoir un droit
de «sécession corrective» si la revendication légitime, par cette
minorité, de l’autonomie régionale a été entravée par les autorités
centrales, et, notamment, dans les cas où ce refus d’autonomie s’accompagne
de graves violations des droits de l’homme à l’égard de la minorité
en question. Ce droit est largement défendu dans le cadre de la
doctrine contemporaine de droit international – tout au moins du
point de vue de ce que l’on appelle
de
lege ferenda (c’est-à-dire sur le plan d’une législation
idéale) –, qui établit plusieurs conditions, à savoir, notamment,
l’impossibilité de bénéficier de l’autonomie régionale dans le cadre
de l'Etat existant par la négociation, ou encore dans le cas de
violations généralisées des droits de l’homme par l’Etat vis-à-vis
de membres de la minorité «sécessionniste»

.
28. Dans son Avis consultatif du 22 juillet 2010 sur la conformité
avec le droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance
du Kosovo

,
la Cour internationale de justice (CIJ) ne tranche pas clairement
sur cette question

. La CIJ a
opté pour une interprétation plutôt étroite de la question soulevée
par l’Assemblée générale des Nations Unies, en limitant son avis
à la question de savoir si la déclaration en tant que telle constituait
une violation soit du droit international général, soit du cadre
fixé par la Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations
Unies, ou encore du Cadre constitutionnel mis en place dans le contexte
de la MINUK (la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo). La CIJ a établi que la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008 ne constituait pas une violation du droit international
général, car la CIJ considère que le droit international général
ne contient pas de disposition applicable d’interdiction des déclarations
d’indépendance (d’après la CIJ, la déclaration ne viole pas non
plus la Résolution 1244 ou le cadre mis en place par la MINUK).
La CIJ a développé cet
argumentum a contrario –
autrement dit, elle a fondé sa décision sur le fait que le Conseil
de sécurité des Nations Unies n’a dû adopter des résolutions de condamnation
de déclarations unilatérales d’indépendance que pour répondre à
des cas précis

.
La CIJ note aussi que l'intégrité territoriale ne concerne que les
relations entre Etats. Mais la CIJ n’est pas allée jusqu’à une analyse
des conséquences juridiques de cette déclaration d'indépendance
– en d’autres termes, elle ne s’est pas interrogée sur l’éventualité
de la création d’un nouvel Etat, du fait de cette déclaration

:
la CIJ a déclaré qu’elle n’estimait pas nécessaire, «pour répondre
à la question posée par l’Assemblée générale, d’examiner le point
de savoir si la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la
création d’un Etat, ou de se prononcer sur la valeur des actes de
reconnaissance

, du fait même que l’Assemblée
générale ne lui demandait pas «si le Kosovo a ou non accédé à la
qualité d’Etat»

.
29. Même si l’on devait reconnaître un droit de sécession «correctif»
dans certains cas, des exemples récents tels que celui de la Géorgie
et de l’Ossétie du Sud montrent bien à quel point il serait difficile
d’appliquer une telle règle dans la pratique. Les positions divergentes
de divers Etats – qui correspondent en partie à celles exprimées
par les experts lors de l’audition du 16 décembre 2010 – montrent
qu’une analyse prétendument «objective» des faits est, en fait,
souvent faussée par des considérations politiques. En outre, comme
l’ont souligné les experts, si, en Europe, chaque groupe minoritaire
plus ou moins insatisfait devait se voir accorder un «droit à la
sécession», les organisations internationales – y compris le Conseil
de l’Europe – deviendraient très rapidement ingouvernables, et la
stabilité politique de plus d’un Etat membre serait très sérieusement menacée.
Et, comme cela a été également souligné, très souvent, la sécession
ne résout pas les problèmes de la minorité en question. La plupart
du temps, une telle option ne fait qu’inverser les rôles de la minorité
et de la majorité: autrement dit, la nouvelle minorité risque de
faire l’objet de semblables mauvais traitements de la part de la
minorité d’origine – c’est le cas des Géorgiens en Ossétie du Sud
(Géorgie).
30. Par ailleurs, on peut se poser la question de la durée d’applicabilité
du «droit de sécession» après qu’il a été mis un terme aux mauvais
traitements à grande échelle subis par la minorité considérée. Cette
question s’est posée par exemple au Kosovo après l’effondrement
du régime Milosevic en Serbie et la disposition du nouveau pouvoir
serbe à négocier l’autonomie du Kosovo, sinon son indépendance totale.
Dans son avis consultatif, la CIJ n’a pas non plus donné d’orientations
sur ce point.
31. Etant donné les problèmes liés à un éventuel «droit de sécession
unilatérale» sur la base du droit des groupes minoritaires à l’autodétermination,
les experts ayant participé à l’audition étaient favorables au maintien
d’une interprétation stricte des conditions pouvant donner lieu
à une déclaration de sécession unilatérale. A mon sens, la protection
des droits des minorités telle qu’elle est prévue notamment par
la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des
minorités nationales (STE no 157) est
un moyen approprié pour mettre en œuvre le droit à l’autodétermination.
5.2. Conséquences d’une
sécession illégale
32. Quelles conséquences peut avoir une sécession qui
constitue une violation du droit international? En tout premier
lieu, les autres Etats ont l’obligation de ne pas reconnaître l’entité
sécessionniste. Cela peut se faire dans le cadre d’une résolution
expresse du Conseil de sécurité des Nations Unies – comme dans les
cas cités dans la note de bas de page 22; mais cela peut également
être tout simplement lié à l’obligation des Etats de respecter l’intégrité
territoriale de l’Etat où a eu lieu la sécession

.
Dans ses «Articles sur la responsabilité des Etats»


, la Commission du droit international
établit l’obligation des Etats de refuser de reconnaître et de promouvoir
de quelque manière que ce soit une situation résultant d’une grave
violation du droit international, au sens de l’article 40:
«Aucun
Etat ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une
violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance
au maintien de cette situation» (article 41, paragraphe 2).
33. L’obligation de ne pas reconnaître des Etats dont l’existence
repose sur une violation de l’interdiction de recourir à la force
est explicitement formulée dans les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies concernant le nord de Chypre

; en revanche, pour des raisons
évidentes, il n’a pas été adopté de résolution du même type dans
les cas de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud (Géorgie). Toutefois,
comme l’a souligné le professeur Keller lors de l’audition de décembre
2010, l’Assemblée a condamné la reconnaissance, par la Russie, de
l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, en considérant que cela constituait
une violation du droit international

.
34. En outre, comme l’ont fait observer nos experts, l’Etat qui
a vu l’un de ses territoires tenter de faire sécession continue
à jouir de tous les droits et prérogatives relatifs à l’ensemble
du territoire national – du moins dans la mesure où un contrôle
territorial effectif n’est pas nécessaire. Ainsi, le Gouvernement
de la République de Chypre représente, pour la communauté internationale,
l’ensemble du territoire chypriote – ce qui explique que, le 1er mai
2004, l’adhésion de Chypre à l’Union européenne se soit appliquée
à l’ensemble du territoire de l’île. Cependant, les habitants de
la zone géographique qui ne relève pas de fait du Gouvernement chypriote
ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages liés à l’adhésion.
A cet égard, le Protocole no 10 du Traité
d’adhésion suspend l’application de la législation de l’Union européenne
à la zone territoriale en question. Cela ne pourra changer qu’après
l’entrée en vigueur d’un éventuel règlement de la question chypriote:
en l’occurrence, les réglementations adoptées par l’Union européenne
pourront s’appliquer à l’ensemble de Chypre

. Parallèlement, le refus de la Turquie
de reconnaître la République de Chypre (et le fait que la Turquie
soit le seul Etat à reconnaître la «République turque de Chypre
du Nord») constitue un obstacle majeur à l’adhésion de la Turquie
à l’Union européenne

.
35. Afin de garantir la protection des droits de l’homme dans
les cas de sécession illégale, la Cour européenne des droits de
l’homme a établi une jurisprudence par laquelle la puissance occupante
est considérée comme responsable des violations commises sur le
territoire qu’elle contrôle de fait. La Cour a établi cette jurisprudence
en traitant le dossier de la disparition forcée des ressortissants
chypriotes grecs à la suite de l’intervention militaire turque de
1974

et ceux des droits de propriété

de Chypriotes grecs
déplacés du fait de la prise de pouvoir effective des autorités
turques dans la partie septentrionale de Chypre et de la présence,
sur cette partie du territoire chypriote, d’importantes forces militaires
turques. Cette jurisprudence s’est également appliquée à l’affaire
Ilascu

, dans laquelle la Fédération de Russie
et la République de Moldova ont été jugées responsables de la détention
illégale d’un opposant politique aux autorités implantées de fait
en Transnistrie à la suite du contrôle territorial, par l’armée
russe, de cette région sécessionniste de la Moldova. Cette jurisprudence
de la Cour est totalement conforme à une conception de la souveraineté nationale
davantage axée sur les droits de l’homme, évoquée plus haut

.
5.3. Renforcement du
multilatéralisme et garanties bilatérales
36. Un autre aspect de l’évolution du concept de souveraineté
nationale est le renforcement du multilatéralisme – par opposition
aux actions unilatérales.
37. Concernant la «responsabilité de protéger», nous avons déjà
souligné qu’un mandat multilatéral – fondé, de préférence, sur une
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies – était nécessaire
pour justifier une intervention humanitaire. Les exceptions très
réservées invoquées par la CIISE en cas de blocage du Conseil de
sécurité, exigent au minimum le soutien d’une organisation régionale.
Par conséquent, on peut affirmer très légitimement que les interventions
unilatérales, ou celles fondées sur des accords de garanties bilatéraux
ou plurilatéraux ne correspondent plus à l’esprit actuel du droit
international public.
38. Le cas de Chypre illustre bien ce point. Comme le faisait
observer le professeur Herdegen lors de l’audition de décembre 2010,
on peut douter de la validité actuelle du «Traité de garantie» de
1960 concernant Chypre, dans la mesure où ce traité n’est peut-être
plus applicable en vertu du principe du Wegfall
der Geschäftsgrundlage (c’est-à-dire la disparition des
circonstances fondamentales sur lesquelles ce traité était basé)
ou du fait de la violation de l’accord par l’une des deux parties
(à savoir l’intervention unilatérale de l’armée turque en 1974).
39. En fait, le «Traité de garantie» concernant Chypre pourrait
être considéré comme nul selon l’argument ci-dessus évoqué par le
professeur Herdegen, dans la mesure aussi où ce traité semble être
contraire aux articles 2.4 et 103 de la Charte des Nations Unies,
ainsi qu’à une norme impérative du droit international qui interdit
le recours à la force. L’article 2.4 de la Charte des Nations Unies
limite de manière importante les conditions dans lesquelles un Etat
pourrait recourir légalement à la force sur le territoire d’un autre
Etat. Cet article 2.4 dispose spécifiquement que «les membres de
l’Organisation [des Nations Unies] s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force,
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies». Il est assez probable qu’un traité autorisant,
en termes généraux, une action militaire sur le territoire de l’une
des parties au traité – et ce, indépendamment de tout consentement
de la Partie en question, au moment précis concerné – serait contraire
à une norme impérative du droit international
(jus
cogens), dans la mesure où l’interdiction du recours
à la force, établie à l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies
est généralement considérée comme le fondement même de cette norme
impérative. Dans le même esprit, le traité en question serait également
nul en vertu du principe établi à l’article 53 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités

.
Enfin, le traité en question serait rendu inopérant par l’article
103 de la Charte des Nations Unies, qui dit ceci: «En cas de conflit
entre les obligations des Etats membres des Nations Unies en vertu
de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre
accord international, les premières prévaudront.»
40. De toute manière, tout traité ou instrument tel que le «Traité
de garantie» relatif à Chypre est considéré comme inadéquat par
décision du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies
aux termes des dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. L’obsolescence de ce traité de garantie peut également remettre
en question la légitimité actuelle des «Sovereign Base Areas» (bases
souveraines britanniques) d’Akrotiri et de Dhekelia

– fondées sur
un autre élément de l’ensemble des traités de décolonisation ayant
conduit à l’indépendance de Chypre, intitulé «Traité relatif à l’établissement
de la République de Chypre». On peut douter du fait qu’un «traité
injuste», que Chypre a été contrainte de signer pour pouvoir s’émanciper
du pouvoir colonial, en 1960, puisse encore justifier que des territoires
aussi importants que les «bases souveraines» échappent au contrôle
de l’Etat chypriote souverain.
6. Conclusion
41. Nous avons pu constater l’évolution des concepts
de «statut d’Etat» et de «souveraineté nationale». Les critères
constitutifs du statut d’Etat englobent désormais des éléments aussi
fondamentaux que le respect de la démocratie, de l’Etat de droit
et des droits de l’homme, ainsi que des garanties en faveur des
groupes ethniques et des minorités, ou encore l’obligation de règlement
pacifique des conflits. La notion de souveraineté nationale a évolué
pour devenir aujourd’hui une «souveraineté dans le cadre du droit»
– autrement dit une souveraineté inscrite dans le droit et limitée
par celui-ci (y compris par les normes internationales en matière
de droits de l’homme). A la lumière de ces évolutions, la Commission
internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats
a établi le concept de «responsabilité de protéger» collective, et
qui, dans certaines circonstances, peut empiéter sur le concept
traditionnel de souveraineté nationale; cette «responsabilité de
protéger» se substitue aux «garanties» bilatérales ou plurilatérales,
qui deviennent progressivement obsolètes.
42. La conclusion majeure consiste à dire que ces évolutions récentes
sont loin d’être achevées et ont encore un caractère polémique,
à la fois sur le plan juridique et en termes d’évaluation des situations
concrètes sur le terrain. A mon sens, la contribution importante
de la CIISE au développement et à la clarification du concept de
«responsabilité de protéger» indique la voie à suivre: une conférence
de suivi des travaux de la CIISE, qui réunirait, sous l’égide des
Nations Unies, d’éminents praticiens et universitaires représentant
toutes les régions du monde et les traditions en matière de droit
international, devrait aborder les questions juridiques internationales
encore conflictuelles – y compris celles soulevées dans le présent
rapport, mais sans s’y limiter.