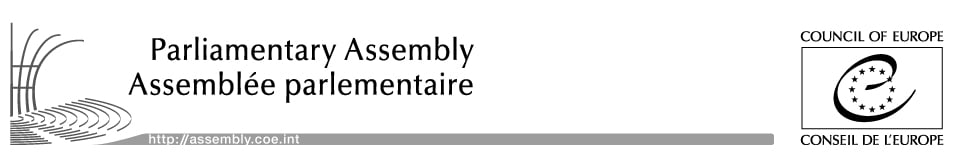1. Introduction
1.1. La
procédure
1. Le 20 juin 2016, l’Assemblée
parlementaire a renvoyé à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme deux propositions de résolution, intitulées
«Restreindre les droits pour protéger la sécurité nationale – jusqu’où
les États peuvent-ils aller?» et «Problèmes juridiques posés par
la guerre hybride», pour qu’elles fassent l’objet d’un rapport unique

. À l’occasion de sa réunion du 10 octobre 2016,
à Strasbourg, la commission m’a nommé rapporteur. Au cours de sa
réunion du 13 novembre 2017 à Paris, la commission a procédé à une
audition avec la participation de M. Andrey L. Kozik, professeur
agrégé, Secrétaire général de l’Association internationale de droit
international et d’arbitrage (Bélarus), de M. Robin Geiß, professeur,
chaire de droit international et de sécurité, Faculté de droit de
l’Université de Glasgow (Royaume-Uni), et Dr Aurel Sari, maître
de conférences en droit, Directeur du Centre de droit international,
Faculté de droit de l’université d’Exeter (Royaume-Uni).
1.2. Les
questions en jeu
2. Pour établir ce rapport, je
prendrai en compte diverses questions soulevées dans ces deux propositions. La
proposition intitulée «Restreindre les droits pour protéger la sécurité
nationale – jusqu’où les États peuvent-ils aller?» indique que les
tentatives de restrictions des libertés fondamentales prétextent
désormais la nécessité de se défendre contre une «guerre hybride»
non déclarée, une notion qui n’a pas de définition juridique. Certains
États membres du Conseil de l’Europe incriminent ainsi l’expression
d’opinions considérées comme une menace pour l’État. Les signataires
de cette proposition rappellent que la défense de l’ordre constitutionnel
et de la sécurité nationale peuvent être des buts légitimes justifiant
les restrictions imposées à certains droits de l’homme et libertés
fondamentales, à la condition que ces restrictions soient compatibles avec
les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5, «la Convention»), telle qu’interprétée
par la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»). L’Assemblée
devrait examiner ces questions à la lumière des normes du Conseil
de l’Europe pour déterminer si ces restrictions peuvent se justifier
et à quelles conditions.
3. La seconde proposition de résolution porte sur la notion de
guerre hybride, fréquemment utilisée, par exemple, au sujet du conflit
militaire en cours en Ukraine et des activités de Daech. Selon cette
proposition, la guerre hybride constitue une menace d’un genre nouveau,
fondée sur la combinaison de moyens militaires et non militaires,
notamment les cyberattaques, les campagnes de désinformation massive
lancées sur des médias sociaux, la perturbation des communications
et bien d’autres moyens. Face au recours généralisé à ces nouvelles
tactiques, surtout lorsqu’elles sont combinées, il y a lieu de se
demander si les normes existantes sont adaptées. L’Assemblée devrait
donc recenser les lacunes du droit pour élaborer des normes appropriées
permettant de prendre des mesures défensives, même en l’absence
d’attaque armée directe par un autre État. Ces mesures offriraient
également des garanties contre l’application sélective du droit international.
4. Vu le contenu de ces deux propositions, je me sens obligé,
en ma qualité de rapporteur, d’examiner en même temps deux ambitions
aussi bien contradictoires que complémentaires: d’une part, comment
définir la «guerre hybride» ou les «menaces de guerre hybride» et
identifier les mesures qu’un État peut prendre à juste titre pour
se défendre contre ces actes, dans le respect du droit international
et, d’autre part, comment protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales lorsqu’un État les restreint dans le but
de se défendre contre les divers actes de guerre hybride dont il
est la cible de la part d’un autre État ou d’un acteur non étatique puissant,
comme Daech. Pour ce qui est de la deuxième question, rappelons
que l’Assemblée a déjà examiné le problème des restrictions imposées
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans l’intérêt
de la sécurité nationale et de la sûreté publique dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme (voir, en particulier, les rapports
et les résolutions sur «Les droits de l’homme et la lutte contre
le terrorisme» et «La sécurité nationale et l’accès à l’information»

). L’Assemblée a
réaffirmé à de nombreuses occasions que le terrorisme peut et doit
être effectivement combattu par des moyens qui respectent pleinement
les droits de l’homme et l’État de droit

.
1.3. Les
menaces hybrides: un phénomène croissant
5. Ces dernières années, les menaces
de guerre hybrides sont devenues l’une des premières préoccupations
de sécurité dans les États membres du Conseil de l’Europe. D’une
part, les experts américains et européens en matière de sécurité
évoquent souvent la menace croissante à plusieurs niveaux que représente
la Fédération de Russie pour la sécurité, en citant l’exemple des
opérations hybrides russes menées dans l’est de l’Ukraine, en Crimée
ou en Géorgie

. En 2016, les questions relatives
à ce conflit ont été examinées par notre commission dans le rapport
de Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE)
sur «Les recours juridiques contre les violations des droits de
l’homme sur les territoires ukrainiens échappant au contrôle des autorités
ukrainiennes», par la commission des
questions politiques et de la démocratie dans le rapport de Mme Kristýna
Zelienková (République tchèque, ADLE) sur les «Conséquences politiques
du conflit en Ukraine» et par la commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées dans le rapport de M. Egidijus Vareikis
(Lituanie, PPE/DC) sur les «Conséquences humanitaires de la guerre
en Ukraine»

. D’autre part, ce
terme est aussi utilisé par les stratèges russes pour désigner les
initiatives prises par les pays occidentaux pour déstabiliser des
«gouvernements inamicaux»

. Ainsi, les responsables russes établissent
un parallèle direct entre la guerre hybride et les tentatives visant
à porter atteinte à l’intégrité de gouvernements dans le cadre des
révolutions dites «de couleur» dans les anciennes républiques soviétiques,
par exemple en Géorgie en 2003 ou en Ukraine en 2004. Pour le ministre
russe de la Défense, Sergueï Choïgou, «les révolutions de couleur
prennent de plus en plus la forme de guerres et sont conçues selon
les règles de la guerre»

.
6. Il convient de noter que l’utilisation de moyens de guerre
non militaires n’est ni nouvelle (selon certains chercheurs, cette
«hybridité» remonte à la guerre du Péloponnèse

) ni propre à un pays

.
Les avancées technologiques s’accompagnent cependant de nouveaux
moyens de guerre et de pouvoir souples. Les menaces hybrides visent
les points faibles d’un pays, souvent dans le but de mettre à mal
ses caractéristiques essentielles (par exemple son régime et son
idéologie politiques, son économie, son intégrité territoriale).
C’est tout particulièrement le cas dans le domaine de la cybersécurité.
Aujourd’hui, notre grande dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques
et des réseaux numériques a complètement reconfiguré la conception
et le fonctionnement des systèmes énergétiques, financiers, de télécommunication
et de transport – c’est-à-dire tout ce qui constitue l’infrastructure
essentielle d’un pays. Elle a également changé la manière de protéger
la démocratie et les droits fondamentaux, en particulier la liberté
d’expression et l’accès à l’information. Certains phénomènes récents,
tels que la «guerre de l’information» (qui n’est pas nouvelle en
soi mais qui a pris une dimension redoutable) et les «cyberattaques»,
qui ne sont pas géographiquement limitées, illustrent parfaitement
ces nouveaux défis.
7. La «guerre de l’information», qui est définie par certains
chercheurs comme le «conflit ou la lutte entre deux ou plusieurs
groupes dans l’environnement de l’information»

, vise à
imposer un point de vue particulier à une population en «créant
[une] domination impénétrable, active et offensive de l’information»

. Le but d’une «guerre de l’information»
est de gagner la confiance de la population

. En fait, cette
forme de guerre associe la guerre électronique (notamment les contre-mesures
électroniques et le brouillage), la cyberguerre (qui sera analysée
en détail plus loin) et les opérations psychologiques («psyops»)
qui visent à saper le moral et altérer le bien-être des citoyens
d’un pays, par exemple en diffusant de fausses informations dans
les réseaux sociaux et les médias). Ces campagnes semblent avoir
le plus de succès dans des régions déjà instables. Les campagnes
russes de désinformation, par exemple, ont trouvé un terrain propice
en Crimée et dans la région du Donbass, où une partie de la population
était déjà prête à accepter la lecture russe des événements

.
Dans son rapport sur «les conséquences politiques du conflit en
Ukraine», la commission des questions politiques et de la démocratie
a souligné que l’action de la Russie se traduisait également par
une intense guerre d’information ou de propagande «qui est presque
aussi dangereuse que le conflit militaire»

. Il est donc compréhensible que
les États qui comptent une minorité ethnique russe soient préoccupés
par une telle menace, même si l’on constate que les États-Unis et
d’autres pays européens sont également exposés à ce phénomène. En
outre, le fait de vouloir exercer une influence systématique sur
l’opinion publique et les processus électoraux n’est pas un phénomène
nouveau en soi, mais son ampleur a considérablement augmenté ces
dernières années. L’exemple des États-Unis, où 126 millions de citoyens
ont été prétendument soumis à la désinformation russe avant l’élection
présidentielle de 2016, est un exemple particulièrement frappant
à cet égard

. On note que des ingérences
similaires dans le processus électoral ont apparemment eu lieu en
Allemagne, en France et dans certains pays de la région des Balkans.
8. Dans la guerre de l’information, l’absence d’obligation de
rendre des comptes pour les propos tenus en ligne et l’absence d’attribution
de la paternité de ces propos ne facilitent pas la tâche des États
qui cherchent à déterminer ce qui relève de la liberté d’expression
et ce qui peut être qualifié d’ingérence étrangère. Cette tâche
est particulièrement difficile en cas de financement étranger.
Sputnik news et
RT (anciennement
Russia Today), par exemple, ont
des filiales européennes et sont financés par des actifs russes,
tandis que le média conservateur américain
Breitbart
News a ouvert des bureaux en Europe. Dans le débat actuel
sur la façon dont les «fausses nouvelles» (
fake
news) en ligne façonnent l’opinion publique, les enquêtes
sur le lien qui existe entre les puissances étrangères et ces organes
de presse sont déterminantes. Même sans une présence physique dans
un pays donné, des sources de désinformation peuvent pénétrer l’environnement
de l’information et influencer le discours public, en particulier
lorsque l’accès à internet et les contenus en ligne sont libres
et peu réglementés. Les «trolls en ligne» se situent également dans
une zone grise, à mi-chemin entre des individus qui expriment leurs
opinions et des acteurs non étatiques semi-organisés qui agissent
en fonction des priorités politiques d’un État précis. L’exemple
des «usines de trolls» russes

montre qu’il est de plus en plus
difficile de faire la distinction entre la liberté d’expression
des militants en ligne et l’ingérence des États. De plus, l’émission
des programmes audiovisuels au-delà des frontières étatiques soulève
des questions quant au contrôle et à la juridiction exercés sur
le contenu diffusé dans des États dans lesquels le radiodiffuseur
n’est pas établi (par exemple, un radiodiffuseur russe établi en
Suède qui diffuse des programmes dans les pays baltes); ainsi, une
révision de la Directive «Services des médias européens» de l’Union
européenne (2010/13/UE) et de la
Convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe (STE no 132)
pourrait s’imposer.
9. La cyberguerre et les cyberattaques sont une forme de «menace
hybride» particulièrement violente et dangereuse, car elle peut
toucher des infrastructures stratégiques, notamment les systèmes
de contrôle du trafic aérien, les systèmes d’écoulement des oléoducs
ou les centrales nucléaires. Au cours des dix dernières années,
plusieurs pays, notamment des anciennes républiques soviétiques
(Estonie, Géorgie, Lituanie et Ukraine) ou des pays occidentaux
(Allemagne, Finlande, Pays-Bas et États-Unis) prétendent avoir été
la cible de cyberattaques russes. Un certain nombre d’ingérences
très médiatisées ont également eu lieu à plusieurs niveaux stratégiques,
notamment les ingérences russes dans les élections présidentielles
aux États-Unis en 2016 et en Ukraine en 2014. En France, en mai
2017, des dizaines de milliers de messages électroniques et de documents
issus de la campagne d’Emmanuel Macron ont été diffusés juste avant
le second tour de l’élection présidentielle.
10. Certains États ont déjà pris des mesures pour se protéger
des menaces terroristes hybrides. Plusieurs pays européens ont adopté
des lois antiterroristes qui peuvent être utilisées contre de telles
menaces, mais certaines de ces mesures pourraient porter atteinte
aux droits de l’homme (ce que dénonce Amnesty International)

. La cyberguerre peut
conduire les États à restreindre la liberté d’accès des citoyens
à internet, en développant des «techniques de filtrage» visant à
limiter l’accès à certains sites, ainsi que des mécanismes de surveillance
de l’usage que les citoyens font de l’internet, et en poursuivant
pénalement les auteurs d’infractions commises en ligne. Les réactions
des États face aux campagnes de désinformation russes ont déjà des
effets sur leurs citoyens. Par exemple, en Lettonie, Maksim Koptelov
a été condamné à six mois de prison pour une pétition en ligne pacifique
proposant que la Lettonie intègre la Russie. Quelques jours plus tard,
la police a enquêté sur un autre citoyen letton, Deniss Barteckis,
qui avait publié une pétition en ligne appelant la Lettonie à fusionner
avec les États-Unis. Il est tout à fait normal que les États incriminent
des actes qui menacent leur indépendance et leur intégrité territoriale
mais, dans ces deux cas, la réaction des autorités face à une expression
politique pacifique semble disproportionnée. D’autres États ont
également pris des mesures controversées pour contrer des menaces
hybrides. Par exemple, en mai 2017, le président ukrainien, Petro Porochenko,
a pris un décret bloquant l’accès à de nombreux sites internet russes
(y compris des réseaux sociaux). En Allemagne, en juin 2017, le
Bundestag a adopté la loi sur l’amélioration
de l’application des droits sur les réseaux sociaux, qui permet
aux autorités d’infliger des amendes allant jusqu’à 50 millions d’euros
aux entreprises de médias sociaux qui ne seraient pas capables de
supprimer, dans les 24 heures, les discours haineux, les incitations
à la violence et les propos diffamatoires. En France, en janvier
2018, le président Macron a annoncé qu’il fallait une loi spéciale
pour lutter contre les
fake news.
Toutes ces mesures peuvent soulever des questions quant à leur compatibilité
avec la liberté d’expression.
11. Les États sont donc aujourd’hui confrontés à des menaces complexes
à plusieurs niveaux pour la sécurité et prennent des mesures en
conséquence pour remédier à leur vulnérabilité face à ces menaces. Cependant,
cette tendance étant relativement récente, aussi bien au niveau
de la sécurité internationale que nationale, la notion de guerre
hybride reste relativement ambiguë. Ainsi, le premier objectif de
mon rapport sera d’examiner les différentes notions et les défis
juridiques qui en découlent, et en particulier de se demander si la
guerre hybride est une «guerre» au sens du droit international humanitaire.
En outre, le fait que les «guerres hybrides» soient déjà prises
en compte dans les stratégies de sécurité nationale des États nous
permet de passer en revue certaines mesures prises pour contrer
ce type de menaces que présentent les États et/ou les acteurs non
étatiques. Rappelons que la Convention considère la sécurité nationale
comme un but légitime, qui autorise une ingérence dans les droits
de l’homme, sous certaines conditions. Bien qu’une marge d’appréciation
relativement large soit habituellement laissée aux États pour évaluer
les menaces pour la sécurité et décider des mesures à prendre pour
y faire face, les nouvelles mesures prises dans ce contexte doivent
néanmoins respecter le droit des droits de l’homme. S’agissant des
mesures prises pour protéger la sécurité nationale contre les menaces
hybrides, il conviendra donc d’examiner aussi les limites légales imposées
aux États sur le plan des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Problèmes
juridiques liés aux menaces hybrides
2.1. Définitions
12. Selon le Service de recherche
du Parlement européen (EPRS)

, une «menace hybride» est un phénomène
résultant de la convergence et de l’interconnexion de différents
éléments, qui forment ensemble une menace multidimensionnelle et
plus complexe. L’EPRS définit aussi les notions de conflit et de
guerre hybrides en fonction des différents niveaux d’intensité d’une
menace et de l’intention des acteurs impliqués. Un «conflit hybride»
est une situation dans laquelle les parties s’abstiennent de recourir
ouvertement aux forces armées les unes à l’encontre des autres,
privilégiant plutôt une combinaison d’intimidation militaire (sans aller
jusqu’à l’agression), d’exploitation des fragilités économiques
et politiques et de moyens diplomatiques ou technologiques dans
la poursuite de leurs objectifs. Enfin, la guerre hybride est une
situation dans laquelle un pays recourt ouvertement à l’usage de
forces armées contre un autre pays ou un acteur non étatique, en plus
d’une combinaison d’autres moyens (économiques, politiques et diplomatiques).
13. S’agissant des pratiques des États en matière de protection
de la sécurité nationale et de leurs limites légales, il est plus
exact de parler de «menace hybride» ou de «conflit hybride». «Bien
qu’il existe plusieurs définitions des menaces hybrides et que celles-ci
doivent rester adaptables en raison du caractère évolutif desdites
menaces, cette notion vise à exprimer le mélange d’activités coercitives
et subversives, de méthodes conventionnelles et non conventionnelles
(c’est-à-dire diplomatiques, militaires, économiques, technologiques),
susceptibles d’être utilisées de façon coordonnée par des acteurs
étatiques ou non étatiques en vue d’atteindre certains objectifs,
sans que le seuil d’une guerre déclarée officiellement ne soit dépassé»

. De fait, la notion de «menace
hybride» est souvent perçue comme un concept «fourre-tout», utilisé
pour désigner la survenance de menaces simultanées pour la sécurité.
Selon l’EPRS, elle peut couvrir diverses situations, notamment des
actes terroristes (de Boko Haram, d’Al-Qaida ou de Daech), des actions
contre la cybersécurité (voir ci-dessous), des actions de groupes
criminels armés (tels que ceux des cartels mexicains), des différends
maritimes (en mer de Chine méridionale), des contraintes sur l’utilisation
de l’espace orbital, des actes économiques hostiles (comme le blocage
des exportations japonaises par la Chine en 2010) ou des opérations
militaires secrètes (comme l’utilisation d’«hommes verts» en Crimée).
Les «menaces hybrides» peuvent émaner à la fois d’États et d’acteurs
non étatiques et englober des formes de confrontation violentes et
non violentes; l’Union européenne a donné la préférence à ce terme
en raison de la portée de son mandat et s’est principalement concentrée
sur les «menaces pour la sécurité». Cependant, le terme «guerre
hybride», qui met l’accent sur des activités violentes, ne devrait
poser aucun problème à l’OTAN

.
14. Du point de vue juridique, il est plus exact d’utiliser le
terme de «guerre hybride» uniquement lorsqu’il y a conflit armé
et que le droit international humanitaire est, par conséquent, applicable.
Les spécialistes des relations internationales et de l’analyse des
conflits conçoivent la guerre hybride comme la combinaison de menaces
pour la sécurité qui étaient auparavant envisagées séparément. La
notion de guerre hybride combine les capacités cinétiques conventionnelles
à des tactiques et formations irrégulières, comme le terrorisme,
la criminalité transnationale et la prolifération des armes, surtout
lorsque ces agressions sont commises par des acteurs qui sont apparemment
associés à un État particulier sans être officiellement soumis à
son autorité. D’autres moyens non cinétiques et de faible intensité
peuvent aussi entrer dans cette définition, comme les cyberopérations,
la désinformation et la propagande, visant aussi des minorités nationales
ou autres, et la corruption d’acteurs clés au moyen de «fonds occultes»
ou de «budgets parallèles»

. La guerre hybride désigne
à la fois les activités des États et celles d’acteurs non étatiques,
dont on estime qu’elles sont dirigées et coordonnées dans le but
de produire un «effet synergique dans les dimensions physiques et
psychologiques du conflit»

.
15. Pour de nombreux spécialistes, ce type de menaces est intrinsèquement
nouveau. La prolifération de la guerre hybride est encouragée par
«l’émergence de nouveaux acteurs sous-étatiques, de nouveaux types d’armes
et d’une nouvelle représentation idéologique»

.
D’autres chercheurs considèrent que la notion de guerre hybride
est une simple appellation et que les caractéristiques présentées
comme nouvelles pouvaient déjà être observées par le passé dans
les pratiques des États et des acteurs non étatiques. De plus, ces spécialistes
estiment que le terme de «guerre» prête à confusion dans ce contexte.
Néanmoins, il est généralement admis qu’il y a aujourd’hui, outre
les actes de guerre classiques, une prédominance d’actions asymétriques,
non conventionnelles et hybrides, qui sont souvent le fait d’acteurs
non étatiques

. D’ailleurs, les
experts qui ont participé à l’audition qui s’est tenue devant la
commission en novembre 2017 ont souligné que la guerre hybride est
une notion plus politique que juridique et que l’asymétrie est sa
principale caractéristique. Un de ces experts, M. Robin Geiß, a
expliqué qu’il existe de nombreuses définitions de la guerre hybride
et que chacune d’elles renvoie, au fond, à un «usage inattendu et
peu orthodoxe de tactiques de subversion». Un autre, M. Aurel Sari,
a affirmé que la définition des «menaces que représente la guerre hybride»,
qui figure dans la
Déclaration
du sommet du Pays de Galles publiée à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
en septembre 2014, insiste à juste titre sur le fait qu’il s’agit
d’un «large éventail de mesures militaires, paramilitaires ou civiles,
dissimulées ou non» qui sont mises en œuvre «de façon très intégrée».
Cet expert privilégie la notion d’
«adversaire
hybride» qui vise à créer cette asymétrie en exploitant les seuils légaux,
la complexité et l’incertitude, en créant une ambiguïté juridique,
en violant ses obligations légales et en utilisant le droit pour
appuyer son discours stratégique et son contre-discours. Toutes
ces actions visent à créer un environnement juridique qui favorise
ses propres opérations au détriment de celles de sa cible. Cette définition
met l’accent sur l’utilisation du droit comme instrument de guerre
et sur ses aspects aussi bien défensifs qu’offensifs.
16. Il est intéressant de constater que, selon M. Sari, le fait
d’exclure l’usage de la force armée de la définition des «menaces
hybrides» «réduit l’hybridité à un vague synonyme de la complexité».
La notion de «menaces hybrides» devrait être réservée aux situations
dans lesquelles les États ou les acteurs non étatiques emploient
des moyens de guerre non violents comme instruments de guerre, en
les intégrant à l’usage de la force armée ou à la menace du recours
à la force. Les spécialistes n’ont pas montré beaucoup d’intérêt
pour les aspects juridiques de la guerre hybride, car la plupart
des problèmes juridiques liés à cette notion – violation de l’intégrité
territoriale, soutien aux mouvements séparatistes ou non-respect
des accords internationaux – ne sont pas nouveaux. L’ampleur et
la fluidité de cette notion ne facilitent pas son appréciation juridique

.
17. Bien que la notion de menaces hybrides soit qualifiée de concept
«fourre-tout», il n’existe pas de définition universellement admise
et certaines différences conceptuelles peuvent être observées. M. Geiß affirme
qu’il n’est pas nécessaire de définir la guerre hybride, car la
définition actuelle de la «guerre» est suffisante, mais qu’il convient
de préciser en quoi consistent les menaces hybrides. Juridiquement, l’expression
«guerre hybride», qui est de nature politique, désigne un conflit
armé dans lequel sont utilisées des techniques militaires conventionnelles
(mais pas uniquement). J’utiliserai ce terme dans ce sens. Les autres
termes – «menaces hybrides» ou «conflits hybrides» – sont utilisés
pour d’autres moyens «hybrides» – non militaires – de conflit. Sur
la base de cette définition, je n’utiliserai donc que le terme «menaces
hybrides».
2.2. Le
cadre juridique applicable
2.2.1. La
guerre hybride
18. En droit international, le
recours à la force par les États est réglementé par le droit de
faire la guerre ou
jus ad bellum. L’article
2 de la Charte des Nations Unies interdit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force,
«soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies» (paragraphe 4) et réaffirme le principe
de la non‑intervention dans des affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale d’un État (paragraphe 7). L’article 51
de la Charte prévoit une exception au principe énoncé à l’article
2.4: les États ont le droit naturel de légitime défense, individuelle
ou collective, en cas d’agression armée

.
La
Résolution 2625
de l’Assemblée générale des Nations Unies (25 octobre 1970) réaffirme l’interdiction de la menace
ou de l’usage de la force et le principe de non-intervention. Elle
souligne également que «les États ont le devoir de s’abstenir de
toute propagande en faveur des guerres d’agression».
19. Le droit de légitime défense, qui est bien établi en droit
international coutumier, naît d’une attaque armée. Si l’intensité
des opérations d’un adversaire hybride n’atteint pas le niveau nécessaire
ou se limite à la menace du recours à la force, le droit de riposter
en utilisant la force en légitime défense ne peut être invoqué. Dans
l’affaire
Nicaragua
c. États-Unis, la Cour internationale de justice (CIJ) a réaffirmé
que le droit de légitime défense ne peut être exercé qu’en réponse
à une «attaque armée» (interprétation à la lumière de l’article
3(g) de la définition de l’agression jointe en annexe
à
la Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1974). La CIJ a estimé, notamment, qu’une assistance
dispensée à des rebelles sous la forme de fourniture d’armes ou
d’assistance logistique ou autre ne relevait pas de ce droit; elle
précise cependant que l’on peut voir «dans une telle assistance
une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention
dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres États
![(29)
CIJ, arrêt du 27 juin
1986, paragraphe 195: «(...) par agression armée il faut entendre
non seulement l’action des forces armées régulières à travers une
frontière internationale» mais encore «l’envoi par un État ou en
son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou
de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre
un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent» (entre autres)
à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières,
«ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une
telle action».](/nw/images/icon_footnoteCall.png)
». Or cette interprétation crée
un vide juridique entre l’usage de la force et une attaque armée,
vide qui n’est pas pris en compte par les États-Unis, qui considèrent
que tout recours à la force donne, en principe, le droit de légitime
défense. Ils ont donc, tout en luttant contre le terrorisme, élargi
à l’excès la notion de «guerre», tant sur le plan géographique que temporel.
20. Un autre problème se pose avec les attaques armées lancées
par des acteurs non étatiques. Bien que la pratique internationale
ait reconnu que le droit de légitime défense s’étendait à de telles
attaques, la CIJ a déclaré que ce droit ne devait pas être utilisé
si l’attaque trouve son origine à l’intérieur et non en dehors du territoire
de la cible (puisque cela mettrait en jeu l’intégrité territoriale
de l’autre État)

.
Cela signifie que si un État recrute des groupes non étatiques pour
mener une guerre par procuration, il sera plus difficile pour l’État visé
d’attribuer les actes de violence à son adversaire

.
22. Un conflit armé peut présenter un caractère international
(CAI) ou non international (CANI). Le CAI est défini dans l’article
2 commun aux
conventions
de Genève et dans l’
article
1, section 4, du protocole additionnel I, tandis que le CANI est défini dans l’article 3 commun
et dans l’
article
1, section 1 du protocole additionnel II. L’article 2 commun aux conventions de Genève dispose
qu’un CAI est une «guerre déclarée ou (...) tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes».
L’article 3 commun aux conventions de Genève s’applique «en cas
de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant
sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes» (CANI).
Il est généralement admis que deux conditions doivent être remplies:
1) un niveau minimum d’intensité, ce qui signifie que les hostilités doivent
avoir un «caractère collectif» ou que le gouvernement doit avoir
recours à la force militaire plutôt qu’aux forces de police; et
2) les groupes non gouvernementaux doivent être des «parties au
conflit». Plus précisément, les groupes doivent être organisés,
avoir une structure de commandement et mener des opérations militaires

.
23. Si une guerre hybride est considérée comme un CAI, les questions
d’attribution découlant du droit international humanitaire et des
droits de l’homme sont plus simples. Le seuil d’applicabilité du
droit des conflits armés internationaux étant bas, l’adversaire
hybride peut nier sa participation à un conflit armé ou éviter de participer
directement aux opérations de combat. Si les hostilités sont inévitables,
il est dans l’intérêt de l’adversaire d’utiliser des tactiques hybrides
et de mandater des groupes non étatiques afin de dissimuler sa propre
implication. Dans ce cas, c’est le droit des conflits armés non
internationaux, moins contraignant, qui s’applique. La pratique
montre que les États hésitent généralement à reconnaître l’existence
d’un CANI, ce qui affaiblit encore plus la position de l’État cible
et signifie que le conflit doit être traité comme un conflit interne.
24. De nos jours, les guerres officiellement déclarées sont rares
dans les relations internationales. Cependant, ni une déclaration
officielle de guerre ni la reconnaissance officielle d’un état de
guerre ne sont nécessaires pour que le droit humanitaire international
s’applique (voir, par exemple, les articles 2 et 3 de la
IVe Convention
de Genève). Il est intéressant de noter que les États n’ont plus
le monopole de la violence, que le nombre de conflits entre États
a diminué, mais que le nombre de conflits armés non internationaux
(CANI) a considérablement augmenté. De nombreux CANI ont pris une
dimension internationale parce que d’autres États sont intervenus
en faveur d’une ou de plusieurs des parties belligérantes. Les progrès
technologiques ont rendu les conflits actuels plus asymétriques.
25. En cas de conflit armé, notamment de guerre hybride, le droit
international humanitaire et le droit international des droits de
l’homme s’appliquent. La Cour européenne des droit de l’homme a
précisé que, dans des circonstances exceptionnelles, la Convention
peut être appliquée de manière extraterritoriale, en particulier
dans les cas de conflits armés qui surviennent en dehors de la zone
géographique du Conseil de l’Europe

.
Cependant, l’application du droit international des droits de l’homme
est limitée par le droit international humanitaire, qui fonctionne
comme des dispositions particulières (
lex
specialis)

. Conformément à la
jurisprudence de la CIJ, la Cour a considéré dans l’affaire
Hassan c. Royaume-Uni que «même
en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans
la Convention continuent de s’appliquer, quoiqu’en étant interprétées
à l’aune des règles du droit international humanitaire

». En cas de violation de
ce droit, les États sont tenus de poursuivre les auteurs présumés
au titre du droit interne. Divers tribunaux pénaux internationaux
peuvent également engager des poursuites contre les auteurs de ces
violations. Cependant, M. Kozik a expliqué lors de l’audition de
novembre 2017 que le droit international humanitaire comporte des lacunes
et que le mécanisme visant à le faire respecter disposait de faibles
moyens.
2.2.2. Les
menaces hybrides
26. En cas de «menaces hybrides»,
qui ne couvrent pas les actions militaires relevant du droit international humanitaire,
les États devraient en général recourir au droit pénal interne (notamment
aux dispositions sur les crimes terroristes) et au cadre juridique
relatif aux droits de l’homme. Ils peuvent également s’appuyer,
en fonction du type de menace, sur un éventail d’instruments juridiques
internationaux visant des domaines d’action particuliers (tels que
le droit de la mer, la lutte contre le terrorisme, le discours de
haine, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
27. En cas d’actes hostiles non militaires à grande échelle, par
exemple les campagnes de désinformation, il est possible d’invoquer
l’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme,
qui interdit la violation des droits garantis par la Convention.
M. Kozik a souligné qu’un État partie peut, par conséquent, saisir
la Cour européenne des droits de l’homme afin d’engager une action
contre un autre État Partie au titre de l’article 33 de la Convention,
mais il a précisé que l’article 33 ne s’appliquait pas aux groupes
non étatiques employés par des adversaires utilisant des tactiques
hybrides.
28. Concernant les cyberattaques, l’application du droit en vigueur
dans le cyberespace est assez floue, tout comme la riposte que les
États doivent opposer à des cyberattaques pour lesquelles il n’existe
même pas de définition uniformément admise

. En 2013, le Groupe d’experts gouvernementaux
des Nations Unies a publié un rapport dans lequel il déclarait que
le droit international s’appliquait au cyberespace. Deux ans plus
tard, il publiait un
rapport
de consensus sur les normes, règles ou principes du comportement responsable
des États dans le cyberespace, y compris un engagement en faveur
de «la non-intervention dans les affaires intérieures des autres
États»

.
La
Convention
sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe de 2001 (STE no 185)
est le seul instrument international contraignant dans ce domaine.
Également ouverte aux États non membres, elle sert de ligne directrice
à tout pays qui élabore une législation nationale complète contre
la cybercriminalité et de cadre à la coopération internationale.
29. Le Manuel de Tallinn 2.0 sur le droit international applicable
aux cyber-opérations (
Tallinn
Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations) a été publié en février 2017. Cette publication, rédigée
par un groupe de 19 experts en droit international sous les auspices
du Centre d’excellence de l’OTAN pour la cyberdéfense en coopération
(dont le siège se trouve à Tallinn, Estonie), est une initiative
dépourvue de caractère contraignant prise en vue de codifier l’application
du droit international au cyberespace. Il convient cependant de
noter que le manuel représente le point de vue de ses auteurs (et
non la position officielle de l’OTAN) et que les experts ne sont
pas parvenus à se mettre d’accord sur la façon dont le droit international s’applique
à des situations précises (par exemple, les cyberattaques russes
qui auraient été lancées en 2016 contre des serveurs du Comité national
démocrate aux États-Unis). À cet égard, M. Kozik a souligné lors
de l’audition de novembre 2017 que le droit international humanitaire
interdit les attaques directes contre les populations civiles et
les objectifs civils mais que son application n’exclut pas tous
les types de cyberactions visant ces populations et objectifs. La
majorité des auteurs du Manuel 2.0 de Tallinn étaient d’avis qu’il
fallait qu’une cyberagression cause au moins des dommages fonctionnels
(par exemple une panne d’électricité) pour qu’elle soit considérée
comme une «attaque» au sens du droit international humanitaire.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) estime que la définition
de «l’attaque» donnée par le droit international humanitaire s’applique
aux cyberattaques, mais cette opinion fait des controverses parmi
les juristes internationaux

. En outre, il n’est pas facile de
savoir dans quelles situations un État peut invoquer le droit de légitime
défense en cas de cyberattaque. Les États doivent être au moins
autorisés à prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires
pour éviter les conséquences préjudiciables continues ou imminentes d’une
cyberattaque.
2.3. Les
vides juridiques et les solutions possibles
30. En masquant son implication
indirecte dans le conflit, en utilisant des groupes armés non étatiques
pour faire usage de la force et en menant ses opérations à un niveau
d’intensité qui contourne les seuils légaux applicables, un adversaire
hybride peut employer des forces armées contre un autre État tout
en empêchant celui-ci d’assurer sa propre défense, ce qui crée une
asymétrie juridique. L’utilisation du droit pour justifier une guerre
n’est pas une nouveauté (par exemple, l’invasion japonaise de la
Mandchourie en 1931 présente de nombreuses similitudes avec l’annexion
russe de la Crimée en 2014). Pour M. Sari, trois tâches (qui n’ont
pas été examinées jusqu’ici par l’OTAN et l’Union européenne) doivent
être réalisées pour relever ces défis juridiques: 1) élaborer une
définition de la dynamique juridique des menaces hybrides; 2) comprendre
les vulnérabilités juridiques; et 3) renforcer la capacité de préparation,
de dissuasion et de défense dans le domaine juridique

.
31. En ce qui concerne la première proposition, il convient de
souligner que l’asymétrie juridique est une caractéristique propre
à la guerre hybride. S’agissant des vulnérabilités et des défis
juridiques, il est bon de rappeler que, face à des actes qui sont
assimilables à une attaque armée, l’État visé peut recourir à la
force au titre de la légitime défense. Il est clair que le Conseil
de l’Europe n’a aucune compétence dans ce domaine puisque les «questions
de défense nationale» sont exclues du champ d’application de ses
activités sur la base de l’article 1.
d de
son
Statut (STE no 1). Il ne serait
pas inutile, cependant, de se pencher sur les moyens légaux dont
disposent, en cas d’attaque armée, les nombreux États membres de
notre Organisation qui sont membres de l’OTAN et/ou de l’Union européenne.
32. Toute attaque armée contre un membre de l’OTAN déclenche l’article
5 du
Traité
de l’Atlantique Nord, qui permet une réponse collective. Cette disposition
s’étend également aux attaques terroristes dirigées contre un pays
allié depuis l’étranger

. Les menaces
hybrides qui n’atteignent pas le seuil d’une attaque armée peuvent
être traitées sous l’angle de l’article 4 du Traité de l’Atlantique
Nord, qui prévoit que les membres de l’OTAN peuvent se consulter
lorsque l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la
sécurité de l’un d’entre eux est menacée. En général, les États
doivent être capables de contrer les menaces hybrides en recourant
à des contre-mesures proportionnées (représailles).
33. Dans l’Union européenne, l’article 42, paragraphes 1 et 2,
du
Traité
sur l’Union européenne (TUE) précise que «la politique de sécurité et de défense
commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité
commune» et «inclut la définition progressive d’une politique de
défense commune de l’Union» (dont la mise en place est soumise à
une décision du Conseil européen). L’article 42.6 du TUE permet
aux États membres dont les capacités militaires satisfont à des
critères plus exigeants d’établir une coopération structurée permanente
(PESCO). Cette coopération permanente a été établie par
une
décision du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2017. En outre, l’article 42.7 du TUE comporte une clause
d’assistance mutuelle en cas d’agression armée, mais sa portée reste
floue.
34. Il serait bon que l’OTAN et l’Union européenne travaillent
en étroite collaboration pour trouver une définition commune de
la dynamique juridique des menaces hybrides et parvenir à une conception
commune des vulnérabilités juridiques et des problèmes qui en découlent,
notamment l’asymétrie juridique créée par l’utilisation de tactiques
hybrides, les défis à relever sur le plan du droit international,
ainsi que la répartition institutionnelle des travaux menés en vue
de contrer les menaces hybrides. Il faudrait également que les deux organisations
renforcent leurs capacités de préparation, de dissuasion et de défense
dans le domaine juridique. Notons qu’elles ont déjà commencé à prendre
des mesures pour riposter aux menaces hybrides

. En avril 2017,
par exemple, ces deux organisations ont créé
le Centre européen
d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, un groupe de réflexion intergouvernemental basé à Helsinki,
composé de 13 États membres et des représentants de l’Union européenne
et de l’OTAN.
3. Dans
quelle mesure les menaces hybrides peuvent-elles justifier des restrictions
aux droits de l’homme?
35. Pour contrer les menaces hybrides
(en particulier les guerres hybrides), les États Parties à la Convention européenne
des droits de l’homme peuvent se référer à son article 15.1, qui
permet aux États Parties de prendre des mesures dérogeant aux obligations
prévues par la Convention, «en cas de guerre ou en cas d’autre danger
public menaçant la vie de la nation». Une telle dérogation devrait
être faite «dans la stricte mesure où la situation l’exige» et ne
devrait pas être en contradiction avec les autres obligations découlant
du droit international. Les États ne peuvent pas déroger à certains
droits: le droit à la vie (sauf pour les décès résultant d’actes
licites de guerre), l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’esclavage
et du travail forcé, le principe «pas de peine sans loi», l’interdiction
de la peine de mort et le droit de ne pas être jugé ou puni deux
fois pour une même infraction. L’État qui déroge à la Convention
doit en informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Dans
l’affaire
Hassan c. Royaume-Uni 
, la Cour européenne des
droits de l’homme a estimé qu’une dérogation formelle au titre de l’article
15 de la Convention n’est peut-être pas nécessaire lorsque le droit
international humanitaire s’applique, car la Convention doit être
interprétée conformément à d’autres dispositions du droit international,
notamment le droit international humanitaire. Récemment, la France,
l’Ukraine et la Turquie ont déposé des dérogations au titre de l’article
15 de la Convention

.
36. Les États invoquent généralement la «sécurité nationale» lorsqu’ils
luttent contre les menaces hybrides. En vertu de la Convention,
la sécurité nationale (ainsi que, notamment la «sûreté publique»
et la «défense de l’ordre et la prévention du crime») est considérée
comme un «but légitime» permettant aux États de limiter certains
droits: le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté
d’expression et la liberté de réunion et d’association (voir le
paragraphe 2 des articles 8, 10 et 11 de la Convention) ainsi que
la liberté de circulation (article 2.3 du Protocole no 4
à la Convention (STE no 46)), ce droit
pouvant également être restreint pour des questions de «maintien
de l’ordre public»). En outre, elle peut justifier l’expulsion d’un
étranger résidant légalement sur le territoire d’un État sans respecter
les garanties procédurales (article 1.2 du Protocole no 7
à la Convention (STE no 117)). «L’intégrité
territoriale» constitue un autre but légitime de restriction de
la liberté d’expression. Toute restriction à ces droits doit être
«prévue par la loi», «nécessaire dans une société démocratique»
et proportionnée. Une garantie supplémentaire contre les abus est
prévue à l’article 18 de la Convention, qui énonce que les restrictions
permises par la Convention «ne peuvent être appliquées que dans le
but pour lequel elles ont été prévues».
37. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné de nombreuses
affaires dans lesquelles des États ont invoqué la «sécurité nationale»
pour restreindre certains droits de l’homme. Le terme en question n’est
pas clairement défini et reste vague étant donné la marge d’appréciation
dont les États disposent. La Cour lui a donné un certain poids en
l’appliquant à des affaires concernant la protection de la sécurité
de l’État et de la démocratie constitutionnelle contre l’espionnage,
le terrorisme, le soutien au terrorisme, le séparatisme et l’incitation
à la violation des obligations militaires. À l’heure actuelle, elle
demande généralement aux organismes nationaux de vérifier que toute
menace invoquée a un fondement raisonnable et d’évaluer soigneusement
la qualité de la loi, la nécessité de l’ingérence ou sa proportionnalité
par rapport à la menace pesant sur la «sécurité nationale». Je citerai
ci-dessous quelques exemples pertinents de la jurisprudence de la
Cour au sujet des articles 8, 10 et 11 de la Convention

.
38. La surveillance secrète est l’un des principaux cas pour lesquels
la «sécurité nationale» a été invoquée. La Cour considère que la
législation sur laquelle cette ingérence se fonde doit non seulement
être «accessible» et «prévisible», mais encore suffisamment détaillée.
Elle souligne que les États doivent démontrer l’existence de garanties
adéquates et efficaces contre les abus et que l’intérêt des États
à protéger leur sécurité nationale doit être mis en balance avec
la gravité de l’atteinte aux droits consacrés à l’article 8 de la
Convention. Dans l’affaire
Roman Zakharov
c. Russie, qui concerne la surveillance générale des
communications téléphoniques sur le fondement de la loi antiterroriste,
la Cour a relevé des lacunes dans le cadre juridique et a estimé
«qu’un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité
nationale risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif
de la défendre» (violation de l’article 8 de la Convention)

.
Il est intéressant de noter que la Cour examine actuellement un
certain nombre d’affaires concernant l’interception massive de communications
externes par les services de renseignement britanniques et le partage
de renseignements entre le Royaume-Uni et les États-Unis telles
que révélées par Edward Snowden

.
39. S’agissant de la liberté d’expression, la jurisprudence de
la Cour montre que cette juridiction a tendance à ne pas conclure
à des violations de l’article 10 dans les affaires concernant l’interdiction
des incitations manifestes et sans équivoque à la violence. Le droit
à la liberté d’expression n’est pas un droit d’incitation à la violence

. La
Cour a même tendance, au titre de l’article 17 de la Convention,
à exclure de sa protection les commentaires qui peuvent être assimilés
à un discours de haine et à une négation des valeurs fondamentales de
la Convention

. Récemment,
la Cour a également reconnu l’importance d’internet lorsque des
individus exercent leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer
des informations et a examiné les mesures qui bloquent l’accès à
ce réseau. Dans les affaires
Ahmet Yildirim
c. Turquie (portant sur une décision d’un tribunal de
bloquer l’accès à Google Sites) et
Cengiz
et autres c. Turquie (concernant le blocage général de
l’accès à YouTube), elle a constaté des violations de l’article
10 de la Convention

.
La Cour n’a pas, cependant, étudié la question de la «sécurité nationale»
dans ces deux affaires, car elle a jugé que les restrictions n’étaient
pas «prévues par la loi» et n’a pas examiné d’autres critères découlant
du deuxième paragraphe de l’article 10.
40. Dans l’affaire
Stankov et Organisation
macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie concernant l’interdiction de
rassemblements organisés par l’association requérante visant à «la
reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie», les autorités
ont invoqué, entre autres, la sécurité nationale pour justifier
la mesure contestée. Or, selon la Cour européenne des droits de
l’homme, «exiger des changements territoriaux dans des discours
et manifestations ne s’analyse pas automatiquement en une menace
pour l’intégrité territoriale et la sécurité nationale du pays»

. La Cour a
jugé que les preuves d’une incitation généralisée à la violence
ou d’un rejet des principes démocratiques étaient rares et a estimé
qu’il était tout aussi important de sauvegarder les institutions
et pratiques démocratiques que de répondre aux préoccupations de
sécurité nationale (violation de l’article 11 de la Convention).
41. Dans un document thématique intitulé «La prééminence du droit
sur l’internet et dans le monde numérique en général», le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a conclu que «les États qui
veulent poser des limites aux droits fondamentaux sur la base d’une
menace supposée contre la sécurité nationale doivent apporter la
preuve que la menace en question ne peut être contrée au moyen du
droit pénal commun, notamment par des lois spéciales de lutte contre
le terrorisme qui restent dans les limites admises du droit pénal
et de procédure pénale applicables et qui satisfont aux normes internationales
en matière de droit pénal et de procédure pénale». Cette obligation
s’applique également aux mesures prises par les États en lien avec
internet et les communications électroniques. Le non-respect de
celle-ci «porte atteinte à la prééminence du droit international»

.
4. Conclusion
42. Le phénomène des «menaces hybrides»
exige une attention particulière. Bien que ce terme soit largement
utilisé, ses conséquences sur le plan juridique sont moins bien
comprises. Or, de ce point de vue, ce n’est pas tant la définition
de ce phénomène qui importe le plus, mais l’application des normes
du droit international telles que l’interdiction du recours à la
force, le droit international humanitaire et le droit des droits de
l’homme. Il n’existe pas de «droit de la guerre hybride», mais on
compte plusieurs définitions de la guerre hybride. La plupart des
experts conviennent que la principale caractéristique de ce phénomène
est son asymétrie juridique. Les adversaires hybrides exploitent
les lacunes du droit et la complexité de la législation, agissent
par-delà les frontières législatives et dans les espaces sous-réglementés,
exploitent les seuils légaux qui limitent les ripostes et sont prêts
à commettre de graves violations du droit en profitant de l’ambiguïté
du droit et des faits. Ils nient leurs opérations hybrides, afin
de créer une zone grise du droit à l’intérieur de laquelle ils peuvent
agir librement. Parvenir à réglementer la guerre hybride est un
défi, car l’une des parties cherche systématiquement à se soustraire
à ses responsabilités légales.
43. Les inquiétudes des États à l’égard des menaces hybrides qui
pèsent sur leur sécurité nationale sont légitimes, notamment parce
que ces menaces peuvent porter atteinte au cœur même de nos sociétés démocratiques
d’une manière sans équivalent. Comme l’utilisation du large éventail
de moyens hybrides disponibles pour mener un conflit ne fait l’objet
d’aucune limitation internationalement reconnue, les États tentent
de contrer ces nouvelles menaces à l’aide du droit pénal interne.
Certaines mesures internes prises pour faire face à des menaces
hybrides peuvent à leur tour porter atteinte aux droits fondamentaux.
Si les menaces hybrides sont considérées comme un nouveau type de
danger, il n’en reste pas moins que la Convention européenne des
droits de l’homme continue de s’appliquer et que la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme répond aux questions
soulevées par ces nouveaux phénomènes. Les craintes que peut soulever
la lutte contre les menaces hybrides en matière de droits de l’homme
peuvent être atténuées en adoptant l’approche retenue pour les mesures
antiterroristes. Les ripostes des États aux menaces hybrides devraient
être légales et proportionnées. En cas de doute, les États peuvent
toujours demander l’expertise de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise) sur des projets de
loi spécifiques. En ce qui concerne la liberté d’expression, certaines
restrictions visant à contrôler le contenu des informations peuvent
être imposées (en particulier pour lutter contre le discours de haine),
mais elles ne devraient pas être discriminatoires ni entraîner une
censure générale. D’autres difficultés doivent être surmontées.
Il n’est pas toujours possible, par exemple, d’identifier l’adversaire
hybride et d’attribuer la responsabilité des menaces hybrides à
un État précis. De plus, des phénomènes tels que les campagnes de
désinformation peuvent créer un conflit entre certains droits de
l’homme et certaines libertés fondamentales, comme la liberté d’expression,
le droit à l’information et le droit à des élections libres (garanti par
l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention
(STE no 9)).
44. Toute riposte aux menaces hybrides devrait recourir à des
moyens légaux, de contre-espionnage, diplomatiques et militaires.
Bien qu’il ne soit pas compétent en matière de défense, il importe
que le Conseil de l’Europe participe à l’élaboration de réponses
juridiques, en apportant son expertise dans le domaine des droits
de l’homme et en s’appuyant sur l’expérience de l’Union européenne
et de l’OTAN en matière de défense. Si les menaces hybrides et certaines
mesures prises en réaction constituent un danger pour les droits fondamentaux,
la «zone grise» juridique qui entoure actuellement ces nouvelles
menaces met aussi en danger la coopération juridique fondée sur
la confiance mutuelle et la compréhension commune des règles applicables.
Le recours aux menaces hybrides peut également avoir des conséquences
juridiques sur le statut de certains groupes de personnes, notamment
ceux qui appartiennent à des minorités nationales.
45. Pour contrer les menaces hybrides, les États pourraient s’appuyer
sur l’expérience qu’ils ont acquise dans la lutte contre le terrorisme.
Les institutions internationales et les services de répression nationaux
se sont beaucoup investis dans la lutte contre la menace terroriste
et sont particulièrement conscients de la nature transnationale
et évolutive des acteurs non étatiques, qui transparaît dans les
traités internationaux (comme la
Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)) et le droit
pénal national en matière de lutte contre le terrorisme. Le Conseil
de l’Europe a élaboré un cadre général, qui vise à promouvoir et
à protéger les droits fondamentaux dans la lutte contre le terrorisme

. Ce cadre pourrait servir de modèle
pour contrer les menaces hybrides, en respectant pleinement les
droits de l’homme. En outre, le Conseil de l’Europe devrait encourager
les États membres et non membres qui ne l’ont pas encore fait à
ratifier la Convention sur la cybercriminalité et entamer une réflexion
sur son application et son éventuelle amélioration.